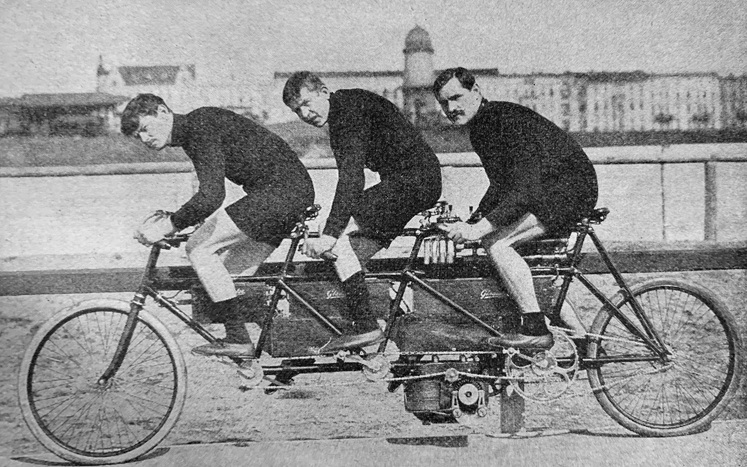
Transmettre les compétences : un défi sous-estimé des entreprises
Près de 40 % des entreprises suisses reconnaissent ne pas avoir de stratégie claire pour préserver leurs savoirs critiques (OFS, 2023). Tandis que les départs à la retraite s’intensifient et que les métiers évoluent rapidement, structurer le transfert de compétences ne peut plus être laissé au hasard. Or, cet enjeu exige bien plus que du bon sens : il convoque des compétences spécifiques en communication, pédagogie, animation de groupe et évaluation – encore trop peu mobilisées dans les organisations.
Communiquer pour transmettre : fondement du transfert de compétences
Transmettre un savoir ne revient pas simplement à « expliquer clairement ». Cela implique de comprendre comment circule l’information, comment elle est reçue, interprétée, intégrée – ou rejetée. La communication est au cœur de la relation pédagogique. Elle structure les échanges, clarifie les attentes et permet de réguler les malentendus.
Selon les travaux de l’Université de Genève, les freins à la communication — qu’ils soient cognitifs, émotionnels ou contextuels — impactent directement l’apprentissage. En contexte de formation, cela signifie que la qualité de l’écoute, la capacité de reformulation et la clarté des messages sont décisives pour un transfert de compétences durable.
Pourquoi c’est important ?
Une mauvaise communication en formation génère frustration, perte d’attention et décrochage. À l’inverse, une relation pédagogique bien construite augmente significativement la rétention des savoirs et l’engagement des apprenants.
Le groupe : facteur d’apprentissage ou facteur de blocage ?
La formation en entreprise se déroule rarement en tête-à-tête. Elle implique des groupes : équipes projet, promotions internes, nouveaux arrivants. Le groupe est à la fois contexte d’apprentissage et acteur de la dynamique pédagogique dans la transmission des compétences.
Les recherches en psychologie sociale et en pédagogie (Piaget, Vygotski, Kolb) ont montré que les groupes peuvent renforcer l’ancrage des savoirs par les interactions entre pairs, le partage d’expériences et la confrontation bienveillante. Mais cela suppose une animation rigoureuse : gestion du rythme, prise en compte des personnalités, régulation des tensions, valorisation de chaque membre.
Quel impact en entreprise ?
Un groupe bien animé stimule l’intelligence collective et crée un climat de confiance propice à l’appropriation des savoirs. À l’inverse, un groupe mal géré peut inhiber la parole, créer de la résistance ou saboter l’apprentissage.
L’apprenant adulte : autonome mais pas autodidacte
Contrairement aux enfants, les adultes ne reçoivent pas un savoir comme une autorité extérieure : ils doivent le comprendre, l’intégrer, et surtout y voir un sens. C’est le fondement de l’andragogie, approche pédagogique développée dans les années 1970 par Malcolm Knowles, et largement enseignée aujourd’hui en Suisse..
Les adultes apprennent mieux lorsqu’ils :
- comprennent la finalité de ce qu’ils apprennent,
- peuvent relier le contenu à leur vécu professionnel,
- disposent d’un cadre qui respecte leurs rythmes cognitifs et émotionnels.
Pourquoi structurer cette approche ?
Parce qu’un apprenant adulte peut résister au changement, douter de sa légitimité ou se sentir fragilisé. Concevoir des formations qui prennent en compte ces réalités permet de sécuriser le parcours, faciliter la transmission des compétences et de maximiser la motivation à apprendre.
Apprendre activement : des méthodes qui mobilisent
Le formateur d’aujourd’hui doit jongler entre plusieurs modalités : cours magistral, mise en situation, jeu de rôle, étude de cas, auto-évaluation, etc. Chaque méthode répond à un besoin pédagogique différent. Les méthodes actives, comme le cycle de Kolb (expérimenter, observer, conceptualiser, réessayer), sont particulièrement efficaces pour transformer un savoir théorique en compétence mobilisable sur le terrain.
Quel bénéfice pour l’entreprise ?
Un collaborateur formé par des méthodes actives retient davantage, applique plus vite, et s’adapte plus efficacement à des environnements complexes. Cela rend la formation plus rentable, en termes d’investissement RH.
Évaluer pour ajuster, ancrer et transférer
L’évaluation est trop souvent réduite à un questionnaire de satisfaction ou à un quiz de fin de session. Pourtant, en pédagogie des adultes, il s’agit aussi d’évaluer :
- la compréhension réelle du contenu,
- la capacité à l’appliquer en contexte,
- la dynamique de groupe et son impact sur l’apprentissage,
- l’évolution des pratiques professionnelles sur la durée.
Pourquoi aller au-delà du contrôle des acquis ?
Parce que l’évaluation est un outil d’apprentissage en soi. Elle permet de réguler en temps réel, de valoriser les progrès, d’identifier les freins, et surtout de valider le transfert des compétences vers l’activité quotidienne (OECD, 2024).
Faire du savoir un levier d’avenir
Le transfert de compétences n’est pas une action ponctuelle. C’est un processus systémique, ancré dans la qualité de la communication, la gestion des groupes, la compréhension fine des mécanismes d’apprentissage et une évaluation structurée. Maîtriser ces leviers, c’est transformer le savoir individuel en intelligence collective durable.
📌 Pour aller plus loin, une formation Swissnova permet d’explorer ces leviers en profondeur, en professionnalisant la posture de formateur interne.
_____________________________________________________

