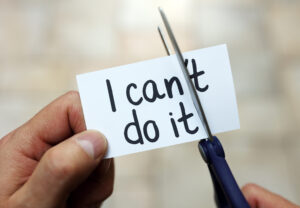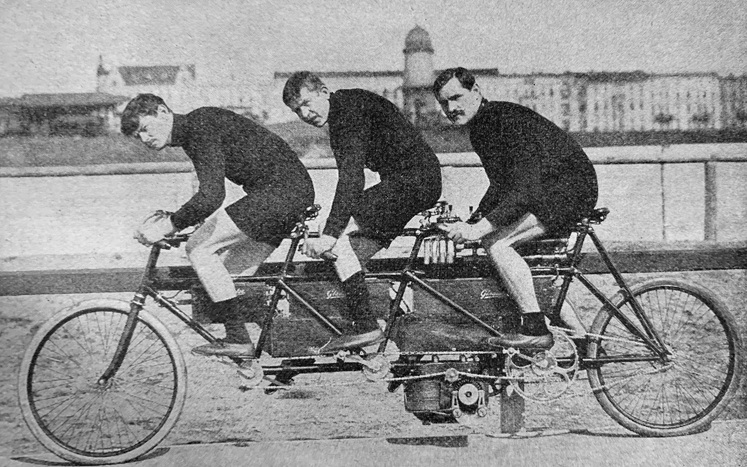par Frédéric Bry | 5 Fév 2026 | Apprendre, Blog, communication, Formation, Formation Entreprise, management, Manager, Non classé, Ressources Humaines
Quelles sont les nouvelles tendances formations professionnelles en 2026? Pour se former efficacement, il faut tenir compte de 3 évolutions importantes dans le monde du travail.
- L’intelligence artificielle transforme l’apprentissage avec des parcours ultra-personnalisés qui s’adaptent en temps réel au niveau et aux besoins de chaque apprenant.
- Les soft skills deviennent prioritaires. Face à l’automatisation, les compétences humaines comme l’intelligence émotionnelle, la résilience et l’adaptabilité sont désormais aussi cruciales que les compétences techniques.
- Les formats hybrides se généralisent, combinant présentiel, distanciel et micro-learning pour s’adapter aux contraintes opérationnelles des entreprises.
La formation en entreprise en Suisse devient donc un investissement stratégique dont l’impact doit être mesurable, intégrant systématiquement les enjeux de RSE et de transition écologique, tout en privilégiant une approche basée sur les compétences concrètes plutôt que sur les diplômes.
Formation Gestion de projets ou comment piloter un projet sans sortie de route.
Chef de projet, un métier qui s’improvise ? Pas vraiment. Entre les délais qui se resserrent, les budgets qui fondent et les imprévus qui surgissent, piloter un projet relève parfois de l’acrobatie. Cette formation décode toutes les phases du projet : initiation, planification, exécution, contrôle, clôture. Mais surtout, elle donne les outils concrets pour ne pas se noyer dans la complexité.
Comment définir un périmètre réaliste ? Gérer les ressources sans se disperser ? Anticiper les risques avant qu’ils ne deviennent des catastrophes ? Au-delà des méthodologies, la formation aborde aussi l’humain : constituer une équipe performante, gérer les attentes des parties prenantes, et communiquer efficacement avec les sponsors. Des simulations sans les conséquences d’un vrai échec.
Pour qui ? Tout professionnel amené à piloter des projets, qu’il soit novice ou expérimenté cherchant à structurer sa pratique.
Team Building : quand l’équipe devient plus forte que la somme de ses talents.
Fini les teams buildings artificiels et les activités sans lendemain. Cette formation va au cœur du sujet : comment transformer un groupe d’individus en une équipe soudée autour d’une vision commune ?
 A travers des ateliers immersifs, les participants découvrent leurs valeurs partagées, alignent leurs ambitions personnelles avec les objectifs collectifs et construisent cette culture collaborative tant recherchée. Le résultat ? Une communication fluidifiée, une confiance mutuelle renforcée, et surtout, des collaborateurs qui ne viennent plus simplement « faire leur job » mais qui s’engagent vraiment.
A travers des ateliers immersifs, les participants découvrent leurs valeurs partagées, alignent leurs ambitions personnelles avec les objectifs collectifs et construisent cette culture collaborative tant recherchée. Le résultat ? Une communication fluidifiée, une confiance mutuelle renforcée, et surtout, des collaborateurs qui ne viennent plus simplement « faire leur job » mais qui s’engagent vraiment.
Idéal pour : les équipes nouvellement constituées, en pleine restructuration, ou qui sentent que « quelque chose manque » dans leur dynamique.
Communication difficile : transformer les tensions en dialogues constructifs.
« Il faut qu’on parle. » Quatre mots qui glacent le sang et font monter le stress. Recadrer un collaborateur, annoncer une mauvaise nouvelle, gérer un conflit ouvert… Personne n’aime ces moments mais tout le monde les vit.
Cette formation donne les clés pour aborder ces conversations redoutées avec plus de sérénité. Pas de recette magique, mais des techniques éprouvées : préparer son intervention, maîtriser ses émotions, pratiquer l’écoute active et utiliser la communication non-violente. Le gros plus ? Des mises en situation réalistes où l’on peut tester, se tromper, ajuster, sans risquer de ruiner une relation professionnelle. On apprend à dire ce qui doit être dit, tout en préservant la relation. Parce qu’en entreprise, on se recroise toujours.
Le déclic : comprendre que les conversations difficiles ne sont pas des échecs mais des opportunités de clarification et de progression.
Développement personnel : investir en soi pour performer durablement.
Et si le meilleur levier de votre performance professionnelle… c’était vous ? Cette formation part d’une conviction simple : on ne peut pas exceller dans son métier si on ne se connaît pas soi-même.
Le parcours explore plusieurs dimensions : découvrir ses vraies valeurs, identifier ses talents cachés, gérer son temps sans s’épuiser, et cultiver ce fameux « mindset de croissance » qui fait la différence. Pas de recettes toutes faites mais des outils concrets pour aligner ce qu’on fait avec ce qu’on est. Au programme : techniques de résilience pour rebondir après un échec, stratégies anti-procrastination, méthodes pour sortir de sa zone de confort (sans violence), et surtout, un regard lucide mais bienveillant sur soi-même.
Parce qu’un professionnel épanoui est un professionnel performant.
Gagner en confiance : oser prendre sa place
Le syndrome de l’imposteur vous dit quelque chose ? Cette petite voix qui murmure « tu n’es pas légitime », « ils vont découvrir que tu ne sais pas », « tu as eu de la chance, c’est tout ». Elle paralyse, elle freine, elle empêche de saisir des opportunités.
Cette formation s’attaque frontalement au manque de confiance. Pas avec des affirmations positives creuses mais en déconstruisant les mécanismes qui le nourrissent : d’où viennent ces croyances limitantes ? Pourquoi minimise-t-on systématiquement ses réussites ? Comment transformer l’échec en apprentissage plutôt qu’en confirmation de ses « incapacités » ?
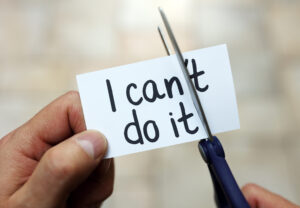
À travers des exercices progressifs, on apprend à oser : exprimer son désaccord en réunion, défendre une idée face à la hiérarchie, accepter les compliments sans les dévier. Le tout dans un cadre bienveillant où chacun avance à son rythme. Le résultat ? Une confiance authentique, pas arrogante qui permet enfin de prendre sa place sans s’excuser d’exister.
L’objectif : arrêter de subir sa carrière et devenir acteur de son évolution.
Leadership : l’art d’inspirer plus que de diriger
On ne naît pas leader, on le devient. Et surtout, le leadership d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec le chef autoritaire qui donne des ordres du haut de sa tour d’ivoire. Cette formation explore le leadership moderne : celui qui inspire, mobilise, délègue intelligemment et crée les conditions de la réussite collective.
Au programme de cette formation management Suisse romande : découvrir les différents styles de leadership (parce qu’il n’y a pas qu’une seule façon de faire), apprendre à adapter sa posture selon les situations et les profils et développer cette présence qui fait qu’on vous écoute vraiment. Vision stratégique, exemplarité, prise de décision dans l’incertitude, intelligence collective… La formation aborde toutes ces dimensions avec un fil rouge : comment développer un leadership authentique qui vous ressemble ?
Le vrai plus ? Des feedbacks personnalisés pour identifier votre style naturel et le renforcer plutôt que d’essayer de copier un modèle qui ne vous correspond pas.
Conduite du changement : faire bouger les lignes sans tout casser.
Réorganisation, digitalisation, fusion, nouveau système… Le changement est partout. Et avec lui, son cortège de résistances, d’inquiétudes et de « on a toujours fait comme ça ». Cette formation donne les clés pour piloter une transformation sans laisser la moitié de l’équipe sur le carreau. De l’état des lieux à la célébration des premières victoires, en passant par la gestion des résistances et la communication de crise, tout le cycle du changement est décrypté.
Le cœur de la formation ? L’humain. Parce qu’un changement, aussi bien pensé soit-il sur le papier, échoue toujours si les personnes ne suivent pas. On apprend à identifier les alliés, comprendre les détracteurs, accompagner les inquiétudes et surtout maintenir l’élan dans la durée.
Les outils : méthodologies éprouvées (Kotter, ADKAR) appliquées à des cas réels, pour savoir réagir face aux situations concrètes du terrain.
Prise de parole en public : du trac au plaisir de convaincre.
Mains moites, gorge serrée, blanc total… La prise de parole en public terrorise même les plus expérimentés. Et pourtant, elle est incontournable : présentation à un client, pitch devant des investisseurs, intervention en conférence.
Cette formation transforme cette épreuve en atout. On y apprend tout : structurer un discours qui marque les esprits, gérer son stress (spoiler : il ne disparaît jamais complètement, mais on apprivoise), maîtriser sa voix et son langage corporel, et surtout, capter l’attention dès les premières secondes. Le secret ? Le storytelling. Raconter des histoires plutôt qu’aligner des faits. Créer de l’émotion plutôt que réciter des slides. Et s’entraîner encore et encore dans un cadre bienveillant où le droit à l’erreur est total.

La progression : on commence par de courtes interventions de 2 minutes et on termine par des présentations complètes, y compris face à un public « difficile » simulé.
Résultat garanti : vous ne verrez plus jamais un micro de la même façon.
Efficacité commerciale : vendre sans vendre son âme.
La vente a mauvaise réputation. Entre les techniques agressives et les closing forcés, beaucoup de commerciaux se sentent mal à l’aise. Et si on pouvait vendre autrement ?
Cette formation propose une approche commerciale basée sur la création de valeur, pas la manipulation. L’idée ? Comprendre vraiment les besoins du client (pas juste placer son produit), construire une relation de confiance (pas juste encaisser un chèque) et créer des solutions sur-mesure (pas réciter un argumentaire). De la prospection intelligente au closing naturel, en passant par le traitement des objections sans pression, toutes les étapes du cycle de vente sont couvertes. Avec un fil rouge : comment être performant commercialement tout en restant éthique ?
Le format : beaucoup de jeux de rôles, des situations réelles et des feedbacks personnalisés pour affiner sa technique. Parce qu’en vente, la théorie ne suffit pas. C’est sur le terrain qu’on progresse.
Négociation : l’art du gagnant-gagnant (non ce n’est pas un mythe).
Négocier, ce n’est pas écraser l’autre pour obtenir le maximum. C’est créer de la valeur pour tous. Facile à dire, moins évident à faire quand la pression monte et que les intérêts divergent.
Cette formation déconstruit les idées reçues sur la négociation. On y apprend à préparer (90% du succès se joue avant d’entrer dans la salle), à identifier la fameuse ZOPA (zone d’accord possible) et à gérer les rapports de force sans tomber dans l’affrontement. Mais au-delà des techniques, la formation explore la psychologie de la négociation : qu’est-ce qui motive vraiment mon interlocuteur ? Comment gérer mes émotions quand ça coince ? Comment détecter (et contrer) les tactiques de manipulation tout en restant intègre ?
Négociation salariale, commerciale, contractuelle ou gestion de conflit : les principes s’adaptent à tous les contextes. Et les simulations permettent de tester différentes stratégies sans risque réel.
📌 Pour aller plus loin, une formation Swissnova permet d’explorer ces leviers en profondeur, en professionnalisant la posture de formateur interne.
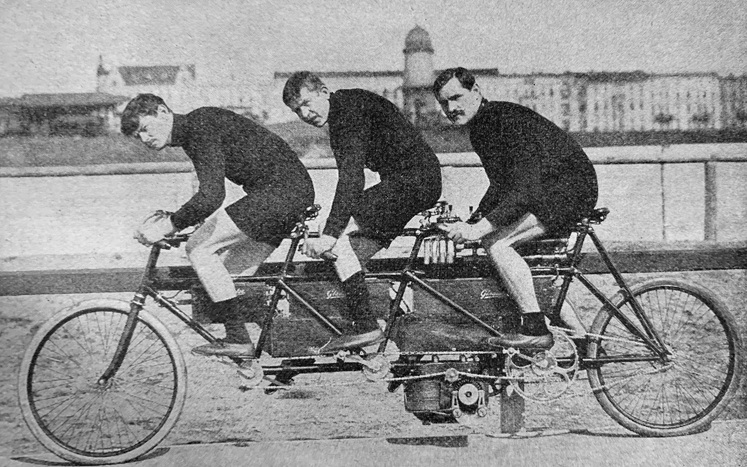
par Content Manager | 8 Sep 2025 | Formation, Formation Entreprise, Management & Organisation, Non classé, Ressources Humaines
Près de 40 % des entreprises suisses reconnaissent ne pas avoir de stratégie claire pour préserver leurs savoirs critiques (OFS, 2023). Tandis que les départs à la retraite s’intensifient et que les métiers évoluent rapidement, structurer le transfert de compétences ne peut plus être laissé au hasard. Or, cet enjeu exige bien plus que du bon sens : il convoque des compétences spécifiques en communication, pédagogie, animation de groupe et évaluation – encore trop peu mobilisées dans les organisations.
Communiquer pour transmettre : fondement du transfert de compétences
Transmettre un savoir ne revient pas simplement à « expliquer clairement ». Cela implique de comprendre comment circule l’information, comment elle est reçue, interprétée, intégrée – ou rejetée. La communication est au cœur de la relation pédagogique. Elle structure les échanges, clarifie les attentes et permet de réguler les malentendus.
Selon les travaux de l’Université de Genève, les freins à la communication — qu’ils soient cognitifs, émotionnels ou contextuels — impactent directement l’apprentissage. En contexte de formation, cela signifie que la qualité de l’écoute, la capacité de reformulation et la clarté des messages sont décisives pour un transfert de compétences durable.
Pourquoi c’est important ?
Une mauvaise communication en formation génère frustration, perte d’attention et décrochage. À l’inverse, une relation pédagogique bien construite augmente significativement la rétention des savoirs et l’engagement des apprenants.
Le groupe : facteur d’apprentissage ou facteur de blocage ?
La formation en entreprise se déroule rarement en tête-à-tête. Elle implique des groupes : équipes projet, promotions internes, nouveaux arrivants. Le groupe est à la fois contexte d’apprentissage et acteur de la dynamique pédagogique dans la transmission des compétences.
Les recherches en psychologie sociale et en pédagogie (Piaget, Vygotski, Kolb) ont montré que les groupes peuvent renforcer l’ancrage des savoirs par les interactions entre pairs, le partage d’expériences et la confrontation bienveillante. Mais cela suppose une animation rigoureuse : gestion du rythme, prise en compte des personnalités, régulation des tensions, valorisation de chaque membre.
Quel impact en entreprise ?
Un groupe bien animé stimule l’intelligence collective et crée un climat de confiance propice à l’appropriation des savoirs. À l’inverse, un groupe mal géré peut inhiber la parole, créer de la résistance ou saboter l’apprentissage.
L’apprenant adulte : autonome mais pas autodidacte
Contrairement aux enfants, les adultes ne reçoivent pas un savoir comme une autorité extérieure : ils doivent le comprendre, l’intégrer, et surtout y voir un sens. C’est le fondement de l’andragogie, approche pédagogique développée dans les années 1970 par Malcolm Knowles, et largement enseignée aujourd’hui en Suisse..
Les adultes apprennent mieux lorsqu’ils :
- comprennent la finalité de ce qu’ils apprennent,
- peuvent relier le contenu à leur vécu professionnel,
- disposent d’un cadre qui respecte leurs rythmes cognitifs et émotionnels.
Pourquoi structurer cette approche ?
Parce qu’un apprenant adulte peut résister au changement, douter de sa légitimité ou se sentir fragilisé. Concevoir des formations qui prennent en compte ces réalités permet de sécuriser le parcours, faciliter la transmission des compétences et de maximiser la motivation à apprendre.
Apprendre activement : des méthodes qui mobilisent
Le formateur d’aujourd’hui doit jongler entre plusieurs modalités : cours magistral, mise en situation, jeu de rôle, étude de cas, auto-évaluation, etc. Chaque méthode répond à un besoin pédagogique différent. Les méthodes actives, comme le cycle de Kolb (expérimenter, observer, conceptualiser, réessayer), sont particulièrement efficaces pour transformer un savoir théorique en compétence mobilisable sur le terrain.
Quel bénéfice pour l’entreprise ?
Un collaborateur formé par des méthodes actives retient davantage, applique plus vite, et s’adapte plus efficacement à des environnements complexes. Cela rend la formation plus rentable, en termes d’investissement RH.
Évaluer pour ajuster, ancrer et transférer
L’évaluation est trop souvent réduite à un questionnaire de satisfaction ou à un quiz de fin de session. Pourtant, en pédagogie des adultes, il s’agit aussi d’évaluer :
- la compréhension réelle du contenu,
- la capacité à l’appliquer en contexte,
- la dynamique de groupe et son impact sur l’apprentissage,
- l’évolution des pratiques professionnelles sur la durée.
Pourquoi aller au-delà du contrôle des acquis ?
Parce que l’évaluation est un outil d’apprentissage en soi. Elle permet de réguler en temps réel, de valoriser les progrès, d’identifier les freins, et surtout de valider le transfert des compétences vers l’activité quotidienne (OECD, 2024).
Faire du savoir un levier d’avenir
Le transfert de compétences n’est pas une action ponctuelle. C’est un processus systémique, ancré dans la qualité de la communication, la gestion des groupes, la compréhension fine des mécanismes d’apprentissage et une évaluation structurée. Maîtriser ces leviers, c’est transformer le savoir individuel en intelligence collective durable.
📌 Pour aller plus loin, une formation Swissnova permet d’explorer ces leviers en profondeur, en professionnalisant la posture de formateur interne.
_____________________________________________________

par Content Manager | 28 Juil 2025 | Apprendre, compétences, Formation, Non classé, Ressources Humaines
Oublier ce qu’on a appris la veille d’une formation : une expérience familière pour nombre de collaborateurs et de responsables RH. Pourtant, les avancées en neurosciences montrent qu’il est possible d’apprendre mieux, durablement, et avec plaisir. En Suisse, ces apports scientifiques s’invitent peu à peu dans les dispositifs de formation – jusqu’à transformer l’accompagnement des apprentis.
L’apprentissage, une compétence à (ré)apprendre
La formation continue n’est plus un luxe, mais une nécessité stratégique pour les entreprises suisses. Pourtant, une question persiste : pourquoi certains retiennent et appliquent facilement ce qu’ils apprennent… tandis que d’autres oublient dès le lendemain ? À cette interrogation, les neurosciences commencent à apporter des réponses précieuses.
Depuis une quinzaine d’années, les recherches en cognition ont mis en évidence des mécanismes précis qui favorisent (ou freinent) la mémorisation, la concentration et la compréhension en contexte professionnel. Or, ces leviers sont encore trop peu exploités dans la conception des formations en entreprise.
Ce que les neurosciences nous apprennent sur l’apprentissage
Selon le Centre interfacultaire en sciences affectives de l’Université de Genève, l’apprentissage est fortement influencé par l’émotion, la motivation et l’attention soutenue – trois éléments activement modifiables en formation. La plasticité cérébrale, par exemple, montre que le cerveau est capable de réorganiser ses connexions tout au long de la vie, à condition d’y être stimulé de façon adaptée.
Des méthodes issues des recherches en neurosciences éducatives permettent aujourd’hui :
- de faciliter la mémorisation par l’ancrage multisensoriel ;
- d’encourager une pédagogie active et participative ;
- de limiter la surcharge cognitive grâce à des séquences d’apprentissage mieux structurées ;
- de renforcer la consolidation des connaissances via le rappel actif.
Ces approches s’éloignent des formations magistrales pour proposer des expériences plus engageantes, souvent ludiques, mais scientifiquement fondées.
En Suisse, les neurosciences s’invitent dans les pratiques de formation
En Suisse, l’intérêt croissant pour les sciences cognitives se traduit par une évolution progressive des pratiques pédagogiques en entreprise. Plusieurs responsables formation explorent des approches fondées sur la stimulation cognitive active, inspirées des travaux en neurosciences sur la mémorisation, l’attention et l’engagement.
Des outils comme les jeux cognitifs, les cartes mentales, ou encore les techniques de rappel actif sont de plus en plus utilisés pour favoriser l’ancrage des apprentissages. Ces méthodes s’appuient sur des principes validés scientifiquement, notamment ceux décrits par Stanislas Dehaene ou John Sweller sur la charge cognitive.
Les retours d’expérience collectés dans divers secteurs – horlogerie, services publics, PME technologiques – indiquent un impact positif sur la motivation, la participation active et la rétention des connaissances, mais aussi sur la cohésion des équipes apprenantes.
Les apprentis, terrain d’innovation pédagogique en Suisse
En Suisse, la formation duale concerne près de deux tiers des jeunes au sortir de la scolarité obligatoire, selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS, 2023). Ce modèle, fondé sur l’alternance entre école professionnelle et entreprise, offre un terrain propice à l’innovation pédagogique – en particulier pour répondre à une difficulté souvent sous-estimée : apprendre efficacement.
Plusieurs études montrent que les jeunes en apprentissage peinent à structurer leurs révisions, à gérer leur charge cognitive ou à mobiliser des méthodes de mémorisation adaptées. Une enquête menée par l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) indique que près de 40 % des apprentis estiment ne pas savoir “comment bien apprendre”, malgré de bons niveaux de motivation.
Face à ce constat, certains programmes testent des approches basées sur les sciences cognitives. Ces ateliers proposent aux jeunes des outils concrets : cartes heuristiques, jeux d’évocation mentale, méthodes d’espacement des révisions, techniques de rappel actif ou de gestion de l’attention.
Ces pratiques s’appuient sur des travaux reconnus, notamment ceux de Stanislas Dehaene, qui identifie quatre conditions essentielles à un apprentissage durable : l’attention dirigée, l’engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation par répétition.
Ce cadre théorique, validé par l’imagerie cérébrale et de nombreuses méta-analyses (OCDE, 2020), permet d’enrichir les dispositifs de formation sans allonger les contenus. L’objectif n’est pas d’ajouter, mais d’organiser l’apprentissage différemment, en respectant les capacités du cerveau humain.
À terme, ce type de démarche pourrait aider à réduire les écarts de réussite aux examens de fin d’apprentissage, mais aussi à renforcer la capacité des jeunes à s’adapter à de nouveaux contextes professionnels – une compétence attendue par 84 % des employeurs selon le baromètre Adecco–HR Swiss (2022).
Un changement de posture pour les responsables formation
Intégrer les apports des neurosciences ne signifie pas rendre toutes les formations “ludiques” ou gadget. Il s’agit d’un changement de paradigme : passer d’un modèle descendant à une architecture plus souple, itérative, alignée avec les capacités réelles du cerveau humain.
Les directions L&D en Suisse commencent à s’approprier ces données pour concevoir des parcours plus efficaces :
- en adaptant les formats aux rythmes d’apprentissage,
- en favorisant l’engagement émotionnel,
- en misant sur des répétitions espacées et des mises en pratique régulières.
En somme, former en s’inspirant du cerveau, c’est former mieux, pas plus.
Un cerveau bien entraîné vaut mieux qu’un agenda bien rempli
Face à l’accélération des transformations professionnelles, le réflexe naturel serait de multiplier les formations. Mais la quantité ne fait pas la qualité. Les neurosciences nous rappellent que l’apprentissage durable repose sur des mécanismes précis : attention ciblée, répétition espacée, implication active.
Les pratiques pédagogiques qui en tiennent compte montrent déjà des effets concrets : meilleure rétention, plus grande motivation, et un rapport à la formation qui gagne en sens. Il ne s’agit plus simplement de transmettre du savoir, mais de créer les conditions optimales pour qu’il soit compris, mémorisé… et réutilisé.
Dès lors, une question s’impose : dans vos dispositifs de formation actuels, quel espace est réellement laissé au cerveau pour apprendre ? Et si, plutôt que de remplir des calendriers, on formait des esprits capables d’apprendre plus intelligemment, tout au long de la vie ?
👉 Pour aller plus loin, une formation Swissnova permet d’explorer ces leviers en profondeur.
_____________________________________________________________________________________________________________

par Content Manager | 3 Juil 2025 | assessment rh, compétences, Compétences numériques, digitalisation rh, Formation, Formation Entreprise, formation rh, fribourg, generation z, geneve, Neuchâtel, recrutement, Ressources Humaines, soft skills, zurich
Recrutement, formation, évolution des générations, soft skills, digitalisation… Les défis s’accumulent, mais les Ressources Humaines ont aujourd’hui l’opportunité de réinventer leur rôle stratégique. En Suisse, cette transformation est déjà en cours — et elle commence souvent par une remise en question constructive. Une fonction RH plus outillée, plus consciente, peut devenir un levier décisif pour faire grandir l’organisation.
Une fonction RH en pleine redéfinition
Pendant longtemps, la fonction RH a été perçue comme un service support, garant des process administratifs et du respect du droit du travail. Aujourd’hui, ce modèle montre ses limites. Les enjeux actuels dépassent largement la simple conformité : il s’agit de construire une culture, d’accompagner les transformations, de faire vivre une vision à travers les talents.
En Suisse, dans un contexte marqué par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, la transformation digitale et l’évolution des attentes sociétales, les RH doivent devenir des partenaires stratégiques. Cela suppose une nouvelle posture : plus proactive, plus influente, plus connectée aux réalités humaines.
Recruter à l’ère des compétences invisibles
Recruter aujourd’hui, c’est naviguer dans l’incertitude. Les parcours ne sont plus linéaires, les expériences ne se résument pas à un CV, et les compétences comportementales prennent souvent le pas sur les savoir-faire techniques.
Mais comment détecter l’intelligence relationnelle, la capacité d’adaptation ou la résilience à travers un entretien ? Comment éviter les biais de confirmation ? Beaucoup de recruteurs se retrouvent seuls face à ces enjeux.
Une approche structurée — fondée sur l’observation, les mises en situation, les bonnes questions — permet de sécuriser les recrutements tout en respectant la singularité des candidats. Ce savoir-faire ne s’improvise pas : il se développe à travers des formations concrètes, directement applicables.
Transmettre ne s’improvise plus
Le savoir technique ne suffit plus. Dans un monde en constante évolution, transmettre efficacement devient un enjeu stratégique : pour intégrer rapidement de nouveaux collaborateurs, pour maintenir les compétences critiques dans l’entreprise, pour accompagner les changements internes.
Pourtant, nombreux sont les experts métier propulsés formateurs du jour au lendemain, sans outils pédagogiques ni accompagnement. Résultat : des formations peu dynamiques, où l’attention retombe vite, et où l’impact réel est difficile à mesurer.
Se former au rôle de formateur, c’est acquérir des méthodes concrètes pour structurer un module, captiver son public, évaluer les acquis. C’est aussi adopter une posture différente : plus centrée sur l’apprenant, plus orientée vers l’impact. Dans une logique de learning culture, c’est un levier décisif pour les RH suisses.
Générations Y et Z : contrainte ou richesse ?
Dans les entreprises, le dialogue intergénérationnel est parfois complexe. Les plus jeunes attendent flexibilité, feedback, autonomie et sens. Les plus expérimentés valorisent la stabilité, l’expertise, et la loyauté à long terme. Chacun pense parfois que l’autre « ne comprend pas le monde du travail ».
Plutôt que d’opposer ces visions, il est possible de construire une culture inclusive, qui valorise les complémentarités. Mais cela demande une vraie lecture des comportements, des besoins et des ressorts motivationnels propres à chaque génération.
Des formations dédiées permettent de décoder ces différences, d’ajuster les styles managériaux et de créer un climat de confiance. Car au fond, chaque génération aspire à la reconnaissance et à l’utilité — simplement, pas de la même façon.
Et si les outils digitaux servaient l’humain ?
L’automatisation des tâches RH progresse à vive allure : sourcing via IA, onboarding numérique, gestion des performances par plateforme, LMS pour la formation… Ces outils ne sont pas neutres. Mal utilisés, ils déshumanisent ; bien intégrés, ils libèrent du temps pour l’essentiel.
Or, beaucoup de professionnels RH sont encore peu accompagnés dans la prise en main de ces solutions. Ou bien, ils les subissent dans une logique descendante, technocentrée.
Se former à la digitalisation RH, ce n’est pas devenir technicien. C’est comprendre les enjeux derrière les outils, choisir ceux qui ont du sens, et les intégrer à une vision stratégique centrée sur les personnes. En Suisse, où la culture managériale reste attachée à la relation humaine, cette hybridation est cruciale.
Outiller les RH, c’est outiller l’entreprise
Loin d’être une fin en soi, la formation RH est un levier de transformation. Elle donne aux professionnels les clés pour naviguer dans un monde incertain, pour mieux comprendre les humains qu’ils accompagnent, et pour contribuer activement à la stratégie de l’entreprise.
En Suisse, les entreprises qui investissent dans la montée en compétences de leurs RH investissent aussi dans la durabilité de leur culture, la qualité de leur recrutement, et la fluidité de leurs transitions internes.

par swissnova | 14 Avr 2025 | compétence, conflit, Formation, Ressources Humaines
Avec l’intensification des rythmes de travail, la diversité croissante des profils dans les entreprises, et les attentes de plus en plus différenciées entre générations, les tensions dans les collectifs de travail sont devenues quasi inévitables.
En Suisse comme ailleurs, les équipes RH constatent une montée des conflits interpersonnels au sein des organisations, avec des effets clairs sur l’ambiance, l’engagement et la productivité.
Selon une enquête de CPP Global (2008), 85 % des collaborateurs ont déjà été confrontés à un conflit au travail ; un salarié sur trois y est exposé de manière régulière. Pourtant, dans nombre d’entreprises, peu de collaborateurs sont véritablement formés à reconnaître, comprendre et désamorcer ces situations complexes.
Pourquoi cette réalité est un défi critique ?
Parce que les conflits non régulés entraînent des conséquences concrètes : démotivation, stress, turnover, repli sur soi et inefficacité opérationnelle.
Le plus souvent, ces tensions sont gérées de manière informelle, voire non gérées du tout — jusqu’à ce qu’elles explosent ou se cristallisent. Or, le conflit n’est pas toujours nocif : bien accompagné, il peut devenir un levier de transformation, de clarification ou d’innovation.
Selon les travaux de De Dreu & Gelfand (2008), si les conflits déstabilisent les dynamiques d’équipe à court terme, ils peuvent aussi offrir une occasion de redéfinir des rôles, de rouvrir des canaux de communication, ou de réinterroger certaines pratiques.
Mettre en place une culture de régulation active
Les entreprises qui souhaitent professionnaliser la gestion des tensions internes peuvent mobiliser plusieurs leviers :
-
L’instauration d’un cadre clair de dialogue au sein des équipes
-
Le recours à des médiateurs internes ou tiers
-
La mise en place de rituels de feedback transparents
-
L’expérimentation de méthodes comme la matrice Thomas-Kilmann, la communication non violente (CNV) ou les cercles de dialogue
L’enjeu n’est pas d’éradiquer les désaccords — ce qui serait illusoire — mais de construire une capacité collective à les traverser sans dégâts, pour en ressortir renforcé.
La formation comme base, mais pas comme solution miracle
La montée en compétence sur ces sujets relationnels est un passage obligé. Mais former ne signifie pas « tout régler ». Il s’agit plutôt de :
-
Donner des clés de compréhension des conflits de valeurs, de méthode ou de rôles ;
-
Introduire des approches de régulation émotionnelle et de coopération respectueuse ;
-
Structurer un langage commun qui facilite la médiation au quotidien.
Ces dispositifs s’adressent autant aux managers qu’aux équipes, et peuvent être intégrés dans une vision plus large de la régulation du climat social, pilotée par les ressources humaines.
Et maintenant… Quel rôle chacun est-il prêt à prendre dans la prévention des tensions ?
Alors que les environnements de travail deviennent plus hybrides, plus multiculturels et souvent plus incertains, la gestion des conflits ne devrait plus être un sujet « à part », réservé à quelques-uns.
Mais alors, qui doit monter en vigilance ? Qui prend l’initiative ? Jusqu’où une équipe peut-elle s’autoréguler ?
Ces questions invitent chaque organisation à redessiner ses responsabilités partagées — entre RH, managers, collaborateurs et institutions internes de médiation.
Et si c’était le moment de repenser collectivement la place du désaccord dans la culture d’entreprise ?
Références :
De Dreu, C. K. W. & Gelfand, M. J. (2008). Conflict in the Workplace: Sources, Functions, and Dynamics across Multiple Levels of Analysis. Annual Review of Psychology
CPP Global (2008). Workplace Conflict and How Businesses Can Harness It to Thrive
Rosenberg, M. (1999). Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs), La Découverte

 A travers des ateliers immersifs, les participants découvrent leurs valeurs partagées, alignent leurs ambitions personnelles avec les objectifs collectifs et construisent cette culture collaborative tant recherchée. Le résultat ? Une communication fluidifiée, une confiance mutuelle renforcée, et surtout, des collaborateurs qui ne viennent plus simplement « faire leur job » mais qui s’engagent vraiment.
A travers des ateliers immersifs, les participants découvrent leurs valeurs partagées, alignent leurs ambitions personnelles avec les objectifs collectifs et construisent cette culture collaborative tant recherchée. Le résultat ? Une communication fluidifiée, une confiance mutuelle renforcée, et surtout, des collaborateurs qui ne viennent plus simplement « faire leur job » mais qui s’engagent vraiment.