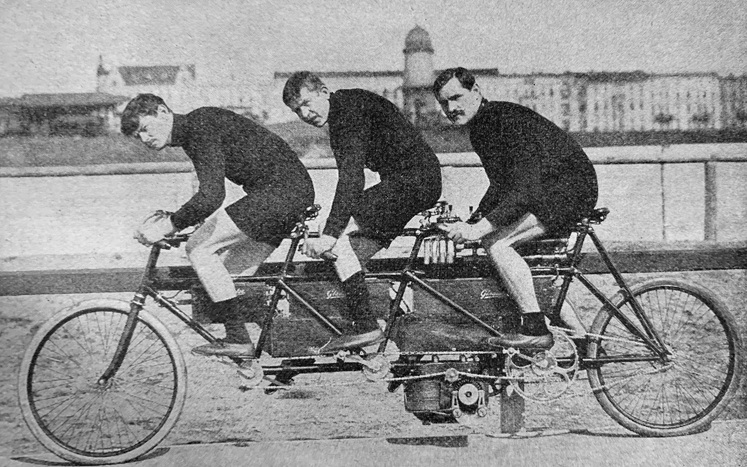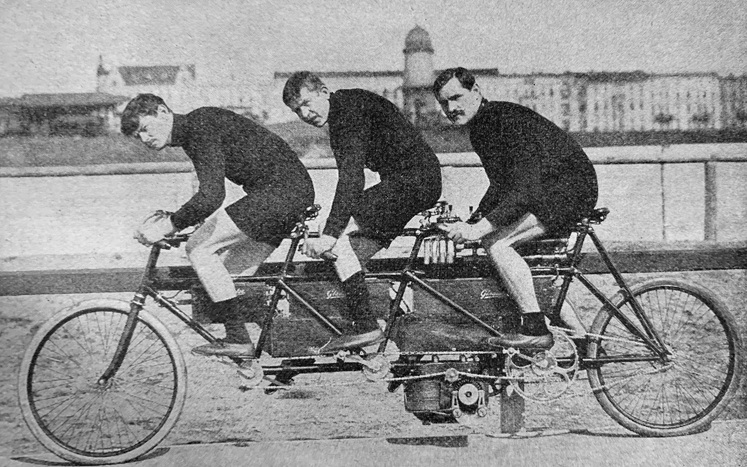
par Content Manager | 8 Sep 2025 | Formation, Formation Entreprise, Management & Organisation, Non classé, Ressources Humaines
Près de 40 % des entreprises suisses reconnaissent ne pas avoir de stratégie claire pour préserver leurs savoirs critiques (OFS, 2023). Tandis que les départs à la retraite s’intensifient et que les métiers évoluent rapidement, structurer le transfert de compétences ne peut plus être laissé au hasard. Or, cet enjeu exige bien plus que du bon sens : il convoque des compétences spécifiques en communication, pédagogie, animation de groupe et évaluation – encore trop peu mobilisées dans les organisations.
Communiquer pour transmettre : fondement du transfert de compétences
Transmettre un savoir ne revient pas simplement à « expliquer clairement ». Cela implique de comprendre comment circule l’information, comment elle est reçue, interprétée, intégrée – ou rejetée. La communication est au cœur de la relation pédagogique. Elle structure les échanges, clarifie les attentes et permet de réguler les malentendus.
Selon les travaux de l’Université de Genève, les freins à la communication — qu’ils soient cognitifs, émotionnels ou contextuels — impactent directement l’apprentissage. En contexte de formation, cela signifie que la qualité de l’écoute, la capacité de reformulation et la clarté des messages sont décisives pour un transfert de compétences durable.
Pourquoi c’est important ?
Une mauvaise communication en formation génère frustration, perte d’attention et décrochage. À l’inverse, une relation pédagogique bien construite augmente significativement la rétention des savoirs et l’engagement des apprenants.
Le groupe : facteur d’apprentissage ou facteur de blocage ?
La formation en entreprise se déroule rarement en tête-à-tête. Elle implique des groupes : équipes projet, promotions internes, nouveaux arrivants. Le groupe est à la fois contexte d’apprentissage et acteur de la dynamique pédagogique dans la transmission des compétences.
Les recherches en psychologie sociale et en pédagogie (Piaget, Vygotski, Kolb) ont montré que les groupes peuvent renforcer l’ancrage des savoirs par les interactions entre pairs, le partage d’expériences et la confrontation bienveillante. Mais cela suppose une animation rigoureuse : gestion du rythme, prise en compte des personnalités, régulation des tensions, valorisation de chaque membre.
Quel impact en entreprise ?
Un groupe bien animé stimule l’intelligence collective et crée un climat de confiance propice à l’appropriation des savoirs. À l’inverse, un groupe mal géré peut inhiber la parole, créer de la résistance ou saboter l’apprentissage.
L’apprenant adulte : autonome mais pas autodidacte
Contrairement aux enfants, les adultes ne reçoivent pas un savoir comme une autorité extérieure : ils doivent le comprendre, l’intégrer, et surtout y voir un sens. C’est le fondement de l’andragogie, approche pédagogique développée dans les années 1970 par Malcolm Knowles, et largement enseignée aujourd’hui en Suisse..
Les adultes apprennent mieux lorsqu’ils :
- comprennent la finalité de ce qu’ils apprennent,
- peuvent relier le contenu à leur vécu professionnel,
- disposent d’un cadre qui respecte leurs rythmes cognitifs et émotionnels.
Pourquoi structurer cette approche ?
Parce qu’un apprenant adulte peut résister au changement, douter de sa légitimité ou se sentir fragilisé. Concevoir des formations qui prennent en compte ces réalités permet de sécuriser le parcours, faciliter la transmission des compétences et de maximiser la motivation à apprendre.
Apprendre activement : des méthodes qui mobilisent
Le formateur d’aujourd’hui doit jongler entre plusieurs modalités : cours magistral, mise en situation, jeu de rôle, étude de cas, auto-évaluation, etc. Chaque méthode répond à un besoin pédagogique différent. Les méthodes actives, comme le cycle de Kolb (expérimenter, observer, conceptualiser, réessayer), sont particulièrement efficaces pour transformer un savoir théorique en compétence mobilisable sur le terrain.
Quel bénéfice pour l’entreprise ?
Un collaborateur formé par des méthodes actives retient davantage, applique plus vite, et s’adapte plus efficacement à des environnements complexes. Cela rend la formation plus rentable, en termes d’investissement RH.
Évaluer pour ajuster, ancrer et transférer
L’évaluation est trop souvent réduite à un questionnaire de satisfaction ou à un quiz de fin de session. Pourtant, en pédagogie des adultes, il s’agit aussi d’évaluer :
- la compréhension réelle du contenu,
- la capacité à l’appliquer en contexte,
- la dynamique de groupe et son impact sur l’apprentissage,
- l’évolution des pratiques professionnelles sur la durée.
Pourquoi aller au-delà du contrôle des acquis ?
Parce que l’évaluation est un outil d’apprentissage en soi. Elle permet de réguler en temps réel, de valoriser les progrès, d’identifier les freins, et surtout de valider le transfert des compétences vers l’activité quotidienne (OECD, 2024).
Faire du savoir un levier d’avenir
Le transfert de compétences n’est pas une action ponctuelle. C’est un processus systémique, ancré dans la qualité de la communication, la gestion des groupes, la compréhension fine des mécanismes d’apprentissage et une évaluation structurée. Maîtriser ces leviers, c’est transformer le savoir individuel en intelligence collective durable.
📌 Pour aller plus loin, une formation Swissnova permet d’explorer ces leviers en profondeur, en professionnalisant la posture de formateur interne.
_____________________________________________________

par Content Manager | 2 Sep 2025 | Formation Entreprise, Management & Leadership, Non classé, Ressources Humaines
Le dialogue intergénérationnel en entreprise devient un enjeu de transformation culturelle. Flexibles mais exigeants, les jeunes actifs bousculent les codes managériaux traditionnels. Les responsables RH doivent-ils y voir une contrainte ou une opportunité ?
Une tension intergénérationnelle réelle mais féconde
Des attentes profondément divergentes
Le dialogue entre générations en entreprise n’a jamais été aussi mis à l’épreuve. D’un côté, les générations X et Baby Boomers, encore bien représentées dans les postes de direction en Suisse, valorisent la loyauté, la stabilité et des carrières linéaires. De l’autre, les générations Y (nées entre 1980 et 1995) et Z (nées après 1995) arrivent avec des attentes inédites. Elles recherchent du sens, une reconnaissance rapide, une flexibilité accrue et un rapport plus horizontal à l’autorité.
Selon le rapport Global Gen Z and Millennial Survey de Deloitte (2023), 74 % des moins de 35 ans en Suisse placent la qualité de vie au travail avant le salaire. Ce chiffre contraste fortement avec la génération X, pour qui la sécurité de l’emploi et la progression hiérarchique restent prioritaires. Le fossé n’est pas uniquement comportemental : il traduit une transformation du contrat psychologique entre l’individu et l’organisation.
Plutôt que de s’en tenir à des jugements comportementaux tels que « Ils ne veulent plus s’engager » ou « Ils ne comprennent pas le monde actuel », il est essentiel d’explorer les fondements de cette évolution. Les jeunes générations ont été façonnées par des crises répétées : économiques, climatiques et sanitaires. Elles ont intégré l’idée que la stabilité n’était plus garantie. Leur rapport au travail s’en trouve modifié : il ne s’agit plus d’y rester longtemps, mais d’y trouver une expérience utile, porteuse de sens et alignée avec leurs valeurs.
Vers une transformation culturelle du travail
Ce changement de paradigme impose aux RH et aux managers de repenser leurs approches en profondeur. Il ne s’agit plus simplement d’adapter des outils ou de corriger des dysfonctionnements ponctuels, mais bien d’engager une transformation culturelle qui reconnaît et valorise la pluralité des attentes et des trajectoires professionnelles. Cela suppose d’instaurer un véritable dialogue organisationnel et intergénérationnel : un espace de régulation où les représentations divergentes du travail peuvent s’exprimer, se confronter et s’enrichir mutuellement. Des phrases comme « Ils ne veulent plus s’engager » ou « Ils ne comprennent pas le monde d’aujourd’hui » illustrent souvent la crispation mutuelle. Mais derrière ces jugements rapides, c’est une incompréhension plus structurelle qui se joue, liée à des référentiels différents sur la temporalité, l’engagement, ou encore la finalité du travail.
Des tensions anciennes dans un contexte nouveau
Ces tensions ne sont pas nouvelles, mais elles prennent une ampleur inédite dans un contexte post-COVID marqué par la digitalisation, la flexibilisation du travail et une redéfinition des priorités de vie. La question n’est donc plus de faire coexister les générations, mais de savoir comment faire dialoguer efficacement des visions du monde fondamentalement différentes.
Une réalité suisse marquée par la diversité des contextes
La Suisse n’est pas un pays uniforme. Cette mosaïque linguistique et culturelle se reflète directement dans le monde du travail. Une enquête de l’Université de Lausanne (2022), menée dans plusieurs cantons, met en lumière des différences marquées dans les attentes professionnelles selon les régions : les jeunes employés alémaniques valorisent davantage l’autonomie, tandis que ceux de Suisse romande placent plus haut la transparence, le climat d’équipe et la reconnaissance. En Suisse italienne, on observe une attente plus hiérarchisée, avec un besoin clair d’identification des rôles et responsabilités.
Une diversité régionale à intégrer dans les pratiques RH
Ces nuances cantonales, qui s’ajoutent aux écarts générationnels, complexifient la tâche des services RH. Là où un modèle de management collaboratif et horizontal fonctionne à Genève, il peut susciter de la confusion ou de la défiance à Saint-Gall ou à Lugano s’il n’est pas correctement contextualisé.
Plutôt que d’imposer un modèle unique de gestion intergénérationnelle, les entreprises suisses ont tout intérêt à adapter leurs pratiques selon le territoire et le profil culturel des équipes. Cela demande un effort supplémentaire : analyse des attentes, ajustement du style de communication, modulation des dispositifs de reconnaissance. Mais c’est aussi une formidable occasion d’enrichir la culture d’entreprise et de favoriser des passerelles entre réalités parfois cloisonnées.
Le rôle stratégique des RH suisses
Dans ce cadre, les RH jouent un rôle clé d’observateurs, de facilitateurs et de médiateurs multiculturels. En comprenant les ancrages territoriaux et générationnels des collaborateurs, ils deviennent de véritables architectes de la cohésion interne.
Repenser les pratiques managériales : une opportunité
Une nouvelle conception du rôle managérial
Le renouvellement générationnel en entreprise ne peut être abordé uniquement à travers la logique du « changement de style ». Il nous confronte, plus profondément, à une transformation des rapports au savoir, à l’autorité et au collectif. Si les attentes des générations Y et Z bousculent les repères managériaux hérités du XXe siècle, elles révèlent surtout une aspiration croissante à un travail vécu comme un espace de sens, de développement et de contribution réelle Le dialogue intergénérationnel en entreprise suisse ne se limite pas à la gestion des différences : il devient un révélateur des cultures implicites de travail.
Dans ce contexte, la formation n’est pas un outil correctif, mais un espace réflexif. Elle permet de déconstruire des habitudes managériales souvent implicites, issues d’une culture de la conformité ou de l’efficacité pure, pour les ouvrir à d’autres logiques : reconnaissance, expérimentation, coopération intergénérationnelle. C’est dans ce cadre que se redéfinit le rôle du manager, non plus comme simple pilote d’activité, mais comme accompagnateur de trajectoires, garant d’un cadre clair et porteur de sens.
Former autrement pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui
Les approches pédagogiques doivent elles aussi évoluer. Il ne s’agit plus de transmettre un savoir figé, mais de créer les conditions d’un apprentissage vivant, ancré dans les réalités de terrain. Le dialogue entre pairs, les études de cas intergénérationnels, la mise en situation réelle deviennent les leviers d’une montée en compétence véritablement transformatrice. Cette dynamique appelle à revaloriser les compétences dites « relationnelles » : capacité d’écoute, gestion du désaccord, médiation entre logiques de temps différentes, etc.
Former dans ce cadre, c’est donner aux managers les outils pour décoder les comportements, anticiper les malentendus et ouvrir des espaces de régulation. Cela exige du temps, de l’engagement et une posture humble. Mais c’est aussi, à terme, ce qui permet de construire une culture du travail durable, inclusive et plus cohérente avec les aspirations du monde contemporain.
Créer les conditions d’un apprentissage collectif durable
On ne pilote pas les attentes des nouvelles générations, on apprend à les comprendre. C’est cette posture d’apprentissage — individuel et organisationnel — que la formation professionnelle peut soutenir si elle est pensée non pas comme une réponse à un problème, mais comme une exploration active des mutations du travail.
Décoder les logiques générationnelles pour mieux collaborer
Une évolution façonnée par les crises
Parler de générations, c’est prendre le risque de généraliser. Pourtant, ignorer ces grandes tendances reviendrait à passer à côté d’un levier de compréhension puissant dans le monde du travail. Ce que les générations Y et Z expriment, ce n’est pas une rupture arbitraire avec le passé, mais une transformation du rapport au travail façonnée par des contextes inédits : crises économiques, urgence climatique, digitalisation accélérée.
Ce que veulent vraiment les générations Y et Z
La génération Y, adulte dans un monde instable, aspire à un travail qui a du sens et qui lui permet d’apprendre, d’évoluer, de contribuer. Elle ne cherche pas un simple emploi, mais un projet qui fasse écho à ses valeurs. Elle attend de son entreprise qu’elle soit transparente, responsable et inclusive. La génération Z pousse ces exigences plus loin : elle ne négocie pas son autonomie, elle l’attend par défaut. Elle souhaite des relations égalitaires, un accès direct aux décisions, et un feedback constant.
Ces attentes ne sont pas des caprices, elles traduisent une conception renouvelée de la place du travail dans la vie : il n’est plus au centre, mais il doit avoir du sens. Cette approche peut dérouter les managers formés dans un autre paradigme. D’où l’importance de les accompagner dans cette lecture culturelle. Le rôle des RH n’est pas d’uniformiser, mais de créer les conditions pour que ces visions du travail, parfois opposées, puissent dialoguer. L’enjeu n’est pas de contraindre les jeunes à s’adapter, mais de structurer un dialogue intergénérationnel en entreprise capable de traduire les aspirations multiples.
Revisiter les outils RH traditionnels
Cela suppose d’interroger nos outils : les entretiens annuels sont-ils encore pertinents ? Le feedback est-il un moment rare ou un échange continu ? Le développement professionnel est-il réservé aux hauts potentiels ou accessible à chacun ?
La formation devient ici un espace de prise de recul collectif. Elle permet de revisiter ces dispositifs avec un regard critique, de les ajuster pour qu’ils fassent sens auprès de toutes les générations. Ce travail d’alignement ne vise pas à lisser les différences, mais à les rendre fécondes. Car c’est souvent dans l’écart — entre rythmes, attentes et références — que naissent les innovations managériales les plus fertiles.
RH : un rôle de médiateur générationnel
Un rôle pivot entre cultures
Face aux attentes contrastées des différentes générations, les services RH ne peuvent plus se contenter d’une approche administrative ou simplement opérationnelle. Leur rôle s’élargit désormais à celui de médiateur culturel. Il ne s’agit pas seulement de répondre aux besoins logistiques d’un personnel diversifié, mais de créer les conditions pour que cette diversité produise de la valeur collective.
Cela suppose une écoute active des signaux faibles : désengagement silencieux des jeunes, tensions implicites dans les équipes, incompréhensions autour des modes de communication ou des critères de performance. La médiation générationnelle passe par une capacité à décoder ces frictions et à les transformer en leviers d’ajustement.
Formaliser des espaces de dialogue intergénérationnel
La diversité générationnelle n’est pas une variable à « gérer » mais une dynamique à orchestrer. Pour cela, les RH doivent instaurer des espaces de parole où les représentations du travail, du temps, de la hiérarchie et du sens peuvent être mises en discussion. Ces conversations ne doivent pas rester anecdotiques ou ponctuelles. Elles doivent s’inscrire dans une gouvernance du travail ouverte, capable d’accueillir les désaccords comme des ressources.
Selon une étude de PwC Suisse (Future of People and Organisation, 2022), les entreprises qui favorisent une culture inclusive et intergénérationnelle constatent jusqu’à 30 % d’amélioration dans l’engagement collaborateur et la capacité d’innovation (source). Une donnée qui souligne l’impact stratégique de cette médiation sur la performance organisationnelle.
Comprendre les représentations générationnelles
De même, l’étude menée par Qualinsight en 2024 auprès de plus de 600 jeunes de Suisse romande confirme que les générations montantes attendent davantage de reconnaissance personnalisée, d’espaces d’écoute et d’implication dans les processus de décision ( Qualinsight – Étude Gen Z 2024). Pour répondre à ces attentes, les RH doivent réinventer leurs pratiques, non en cherchant à tout satisfaire, mais en clarifiant les règles du jeu et en assumant un rôle de facilitateur de sens.
Cette dynamique est confirmée par l’étude SwissSkills 2023, qui souligne que les jeunes suisses de 17 à 27 ans attendent des formations concrètes, alignées sur le monde professionnel et intégrant davantage d’autonomie dans l’apprentissage. L’étude révèle aussi que 54 % des répondants souhaitent une orientation professionnelle plus tardive, mieux liée à l’expérience réelle (SwissSkills Report 2023).
Déployer des leviers d’intelligence collective
Dans cette optique, des dispositifs tels que les baromètres internes de satisfaction, les focus groups générationnels, les entretiens qualitatifs croisés ou le feedback inversé (où les jeunes évaluent les pratiques managériales) prennent tout leur sens. Ils ne servent pas à produire du consensus, mais à cultiver la compréhension mutuelle — condition essentielle pour bâtir une culture d’entreprise résiliente et engagée.
Dans cette perspective, les entreprises suisses peuvent bénéficier d’un accompagnement externe pour structurer ces démarches de manière ciblée, sans alourdir leur fonctionnement. Avec son expertise en dynamique intergénérationnelle et en transformation culturelle, Swissnova intervient aux côtés des équipes RH et managériales pour faciliter l’émergence de dispositifs concrets, adaptés à la réalité du terrain. Il ne s’agit pas de plaquer des solutions prêtes à l’emploi, mais de co-construire des approches durables, alignées avec les valeurs et les objectifs de chaque organisation.
Une nouvelle culture du travail à co-construire
La cohabitation des générations en entreprise n’est pas une équation à résoudre, mais une richesse à orchestrer. Cela ne signifie pas gommer les différences, mais apprendre à en faire des ressources actives. Le dialogue entre visions du travail ne se décrète pas — il se construit, pas à pas, dans les pratiques, les postures et les dispositifs concrets.
En Suisse, où l’innovation sociale s’enracine dans une culture du consensus et de la responsabilité partagée, les conditions sont réunies pour transformer ces enjeux en véritables leviers de renouvellement managérial. Mais cela suppose de dépasser la logique de l’ajustement ponctuel. Il faut penser ces transformations à l’échelle des systèmes : systèmes de reconnaissance, de communication, d’apprentissage.
Vers un nouveau contrat social du travail
C’est dans cette direction que s’ouvrent les réflexions les plus fécondes. Et si, plutôt que de chercher à intégrer les nouvelles générations, on les considérait comme des partenaires d’un nouveau contrat social du travail ? Un contrat plus horizontal, plus flexible, mais aussi plus exigeant en termes d’alignement entre les discours et les pratiques.
Ce chemin ne se fait pas seul. Il appelle à la collaboration entre RH, direction, formateurs, collaborateurs — et à une posture d’apprentissage permanent. Et si le dialogue intergénérationnel en entreprise devenait le point de départ d’un nouveau contrat culturel du travail ?
Pour aller plus loin,Swissnova permet d’explorer ces leviers en profondeur.*
___________________________________________________________________________________

par Content Manager | 28 Juil 2025 | Apprendre, compétences, Formation, Non classé, Ressources Humaines
Oublier ce qu’on a appris la veille d’une formation : une expérience familière pour nombre de collaborateurs et de responsables RH. Pourtant, les avancées en neurosciences montrent qu’il est possible d’apprendre mieux, durablement, et avec plaisir. En Suisse, ces apports scientifiques s’invitent peu à peu dans les dispositifs de formation – jusqu’à transformer l’accompagnement des apprentis.
L’apprentissage, une compétence à (ré)apprendre
La formation continue n’est plus un luxe, mais une nécessité stratégique pour les entreprises suisses. Pourtant, une question persiste : pourquoi certains retiennent et appliquent facilement ce qu’ils apprennent… tandis que d’autres oublient dès le lendemain ? À cette interrogation, les neurosciences commencent à apporter des réponses précieuses.
Depuis une quinzaine d’années, les recherches en cognition ont mis en évidence des mécanismes précis qui favorisent (ou freinent) la mémorisation, la concentration et la compréhension en contexte professionnel. Or, ces leviers sont encore trop peu exploités dans la conception des formations en entreprise.
Ce que les neurosciences nous apprennent sur l’apprentissage
Selon le Centre interfacultaire en sciences affectives de l’Université de Genève, l’apprentissage est fortement influencé par l’émotion, la motivation et l’attention soutenue – trois éléments activement modifiables en formation. La plasticité cérébrale, par exemple, montre que le cerveau est capable de réorganiser ses connexions tout au long de la vie, à condition d’y être stimulé de façon adaptée.
Des méthodes issues des recherches en neurosciences éducatives permettent aujourd’hui :
- de faciliter la mémorisation par l’ancrage multisensoriel ;
- d’encourager une pédagogie active et participative ;
- de limiter la surcharge cognitive grâce à des séquences d’apprentissage mieux structurées ;
- de renforcer la consolidation des connaissances via le rappel actif.
Ces approches s’éloignent des formations magistrales pour proposer des expériences plus engageantes, souvent ludiques, mais scientifiquement fondées.
En Suisse, les neurosciences s’invitent dans les pratiques de formation
En Suisse, l’intérêt croissant pour les sciences cognitives se traduit par une évolution progressive des pratiques pédagogiques en entreprise. Plusieurs responsables formation explorent des approches fondées sur la stimulation cognitive active, inspirées des travaux en neurosciences sur la mémorisation, l’attention et l’engagement.
Des outils comme les jeux cognitifs, les cartes mentales, ou encore les techniques de rappel actif sont de plus en plus utilisés pour favoriser l’ancrage des apprentissages. Ces méthodes s’appuient sur des principes validés scientifiquement, notamment ceux décrits par Stanislas Dehaene ou John Sweller sur la charge cognitive.
Les retours d’expérience collectés dans divers secteurs – horlogerie, services publics, PME technologiques – indiquent un impact positif sur la motivation, la participation active et la rétention des connaissances, mais aussi sur la cohésion des équipes apprenantes.
Les apprentis, terrain d’innovation pédagogique en Suisse
En Suisse, la formation duale concerne près de deux tiers des jeunes au sortir de la scolarité obligatoire, selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS, 2023). Ce modèle, fondé sur l’alternance entre école professionnelle et entreprise, offre un terrain propice à l’innovation pédagogique – en particulier pour répondre à une difficulté souvent sous-estimée : apprendre efficacement.
Plusieurs études montrent que les jeunes en apprentissage peinent à structurer leurs révisions, à gérer leur charge cognitive ou à mobiliser des méthodes de mémorisation adaptées. Une enquête menée par l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) indique que près de 40 % des apprentis estiment ne pas savoir “comment bien apprendre”, malgré de bons niveaux de motivation.
Face à ce constat, certains programmes testent des approches basées sur les sciences cognitives. Ces ateliers proposent aux jeunes des outils concrets : cartes heuristiques, jeux d’évocation mentale, méthodes d’espacement des révisions, techniques de rappel actif ou de gestion de l’attention.
Ces pratiques s’appuient sur des travaux reconnus, notamment ceux de Stanislas Dehaene, qui identifie quatre conditions essentielles à un apprentissage durable : l’attention dirigée, l’engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation par répétition.
Ce cadre théorique, validé par l’imagerie cérébrale et de nombreuses méta-analyses (OCDE, 2020), permet d’enrichir les dispositifs de formation sans allonger les contenus. L’objectif n’est pas d’ajouter, mais d’organiser l’apprentissage différemment, en respectant les capacités du cerveau humain.
À terme, ce type de démarche pourrait aider à réduire les écarts de réussite aux examens de fin d’apprentissage, mais aussi à renforcer la capacité des jeunes à s’adapter à de nouveaux contextes professionnels – une compétence attendue par 84 % des employeurs selon le baromètre Adecco–HR Swiss (2022).
Un changement de posture pour les responsables formation
Intégrer les apports des neurosciences ne signifie pas rendre toutes les formations “ludiques” ou gadget. Il s’agit d’un changement de paradigme : passer d’un modèle descendant à une architecture plus souple, itérative, alignée avec les capacités réelles du cerveau humain.
Les directions L&D en Suisse commencent à s’approprier ces données pour concevoir des parcours plus efficaces :
- en adaptant les formats aux rythmes d’apprentissage,
- en favorisant l’engagement émotionnel,
- en misant sur des répétitions espacées et des mises en pratique régulières.
En somme, former en s’inspirant du cerveau, c’est former mieux, pas plus.
Un cerveau bien entraîné vaut mieux qu’un agenda bien rempli
Face à l’accélération des transformations professionnelles, le réflexe naturel serait de multiplier les formations. Mais la quantité ne fait pas la qualité. Les neurosciences nous rappellent que l’apprentissage durable repose sur des mécanismes précis : attention ciblée, répétition espacée, implication active.
Les pratiques pédagogiques qui en tiennent compte montrent déjà des effets concrets : meilleure rétention, plus grande motivation, et un rapport à la formation qui gagne en sens. Il ne s’agit plus simplement de transmettre du savoir, mais de créer les conditions optimales pour qu’il soit compris, mémorisé… et réutilisé.
Dès lors, une question s’impose : dans vos dispositifs de formation actuels, quel espace est réellement laissé au cerveau pour apprendre ? Et si, plutôt que de remplir des calendriers, on formait des esprits capables d’apprendre plus intelligemment, tout au long de la vie ?
👉 Pour aller plus loin, une formation Swissnova permet d’explorer ces leviers en profondeur.
_____________________________________________________________________________________________________________

par Content Manager | 7 Juil 2025 | compétences, Formation Entreprise, Ressources Humaines
Comment évaluer ce qui ne se voit pas ? Cette question, en apparence philosophique, est devenue l’une des plus concrètes que se posent les professionnels RH aujourd’hui. Face à des parcours de plus en plus discontinus, à la disparition progressive des repères traditionnels (diplômes, années d’expérience, entreprises de référence), et à la montée en puissance des compétences dites « comportementales », le recrutement devient un exercice d’observation, de projection, et parfois d’intuition méthodique.
Ce que l’on attend d’un collaborateur ne tient plus seulement dans un descriptif de poste. On cherche des qualités comme l’agilité relationnelle, la capacité à collaborer dans l’incertitude, le discernement dans les prises de décision ou la capacité à apprendre en continu. Autant de compétences dites « invisibles », parce qu’elles ne s’affichent pas en haut d’un CV et ne se prouvent pas par un simple entretien.
Alors, comment les détecter ? Comment s’assurer que le processus de recrutement permet de révéler ces éléments essentiels, sans tomber dans la subjectivité pure ? Et quel rôle pour les RH, les managers, ou les formateurs dans cette redéfinition des pratiques ?
Ce sont ces questions — à la fois stratégiques, éthiques et très opérationnelles — que nous explorons ici.
La fin des parcours standards ?
Pendant longtemps, le recrutement s’appuyait sur un réflexe rassurant : diplômes, années d’expérience, postes précédents dans des entreprises reconnues. Ce modèle reste encore très présent dans les grilles de lecture des recruteurs en Suisse, notamment dans les grandes organisations publiques ou les secteurs réglementés. Mais dans les PME, les start-ups, les ONG, les milieux culturels ou les métiers de l’innovation, la réalité est différente.
Les parcours sont fragmentés, hybrides, souvent à cheval entre différents secteurs. Certains candidats ont fait plusieurs reconversions, ont appris à coder sur YouTube ou à manager sans titre officiel. Ces profils ne rentrent pas dans les cases, mais ils sont souvent porteurs de valeur. Encore faut-il savoir les lire. Par exemple, un candidat ayant passé dix ans dans le monde associatif, avec des fonctions transversales, peut développer une adaptabilité, une résolution de problèmes ou une intelligence contextuelle hors norme — autant de compétences que ne dévoile pas un intitulé de poste.
Les compétences comportementales, nouveau standard RH
Les soft skills, longtemps considérées comme un « bonus », deviennent aujourd’hui un critère de sélection majeur. Selon le World Economic Forum, les compétences les plus recherchées en 2025 seront la pensée critique, la résolution de problèmes complexes, l’intelligence émotionnelle ou encore l’agilité cognitive. Or, ces qualités sont difficilement mesurables dans un entretien classique.
Du point de vue RH, l’enjeu est double : d’une part, identifier ces compétences sans outils standardisés — car peu d’entreprises disposent d’évaluations prédictives internes —, et d’autre part, définir ce que l’on cherche réellement. Une entreprise en transformation culturelle n‘aura pas besoin des mêmes soft skills qu’une organisation en pleine croissance commerciale. Or, peu de grilles RH prennent en compte cet alignement dynamique entre culture interne et compétences humaines.
Prenons un exemple typique observé dans plusieurs entreprises suisses romandes du secteur technologique et financier : après une phase de croissance rapide post-COVID, nombre d’entre elles ont dû revoir en profondeur leurs critères de recrutement. Si les hard skills restaient indispensables, ce sont les profils capables de s’adapter aux itérations rapides, de communiquer efficacement à distance, et de gérer leur charge émotionnelle qui ont véritablement fait la différence. Dans ces contextes, les services RH ont souvent élaboré, en collaboration avec les managers, des grilles d’entretien spécifiques intégrant ces nouveaux critères comportementaux.
Recruter, un art ou une compétence ?
Beaucoup de managers pensent encore que recruter est une affaire d’intuition. « Je le sens bien » ou « j’ai un bon feeling » sont des phrases courantes… et risquées. Les neurosciences comme les sciences sociales ont largement montré que nos décisions de recrutement sont très souvent biaisées : effet de halo, biais de similarité, préférence pour des profils qui nous ressemblent.
En tant que spécialiste RH, cette intuition ne peut suffire. Le recrutement engage l’organisation sur le long terme, en particulier lorsqu’on parle de postes à responsabilité, de profils rares ou de contextes sensibles (transformation, fusion, crise). Or, les coûts d’un mauvais recrutement ne sont pas anecdotiques : on parle souvent de 1 à 1,5 année de salaire total perdu (selon les données du Harvard Business Review) si l’on intègre les coûts directs (temps RH, intégration, formation) et indirects (perte de productivité, impact d’équipe, image employeur).
D’un point de vue opérationnel, une compétence de recrutement bien développée repose sur plusieurs éléments :
- Une définition claire des critères comportementaux attendus
- Une grille d’observation partagée entre RH et managers
- Une capacité à poser des questions ouvertes, ciblées, non suggestives
- Un entraînement à repérer les biais cognitifs
- Et surtout, un espace de retour critique sur sa propre pratique
Un formateur RH expérimenté le dira : la qualité d’un recrutement repose moins sur la sélection finale que sur la clarté du besoin, la cohérence du processus, et la capacité à structurer l’observation. Dans les formations professionnelles, il n’est pas rare de proposer aux recruteurs des jeux de rôle filmés: le·la recruteur·se mène un entretien simulé, puis analyse sa posture — interruptions, type de questions, non-verbal. Cette étape décentre la perception subjective : on prend conscience, par exemple, qu’un même profil n’est pas questionné de la même façon selon son genre ou son origine — un biais fréquent corroboré par les études.
Cette posture réflexive transforme l’intuition en compétence observable : mieux comprise, contextualisée, enseignable. L’intuition n’est plus aléatoire, elle devient outil, calibré par la méthode.
Loin d’être une formalité administrative, l’entretien devrait être un espace de co-évaluation : un moment où le recruteur explore, observe, fait émerger des compétences invisibles, tout en permettant au candidat de se projeter. Cela suppose une vraie préparation : poser les bonnes questions, écouter activement, capter les signaux faibles.
De plus en plus de recherches en psychologie du travail et en sciences de la gestion recommandent de recourir à des méthodes qualitatives structurées pour accéder à ces compétences comportementales. Par exemple, la Harvard Business Review (2021) recommande l’usage d’entretiens semi-structurés intégrant des situations inattendues ou ambigües pour observer les mécanismes de raisonnement, d’adaptation ou de gestion du stress chez un candidat.
Dans cette perspective, certaines entreprises — notamment dans les secteurs de la tech ou de la santé — intègrent des « questions de rupture » ou des mises en situation volontairement déroutantes pour observer la capacité à garder le cap face à l’imprévu. L’intérêt n’est pas la « bonne réponse », mais la manière dont le candidat structure sa pensée, communique son raisonnement ou rebondit en temps réel.
Ce type d’approche, documenté dans les travaux de Levashina et al. (2014, Journal of Applied Psychology), renforce la validité prédictive de l’entretien tout en conservant une forte dimension humaine. Il transforme le recruteur en analyste de posture et d’interaction, bien au-delà de la simple vérification de parcours ou de compétences déclarées.
Former les managers recruteurs : un levier sous-exploité
De nombreux entretiens en entreprise sont aujourd’hui conduits non par des professionnels RH formés, mais par des managers opérationnels, parfois seuls, souvent sans formation spécifique. Or, ce sont eux qui prennent les décisions finales. Cette réalité soulève un point critique : à la croisée de l’évaluation technique et humaine, le manager joue un rôle central dans le processus de recrutement, sans toujours disposer des outils nécessaires pour en garantir la qualité.
Selon une enquête menée par SocialTalent (2022), les managers non formés constituent le principal facteur de risque dans le processus de sélection. Ils ont tendance à s’appuyer sur leur ressenti, posent parfois des questions inappropriées (voire discriminantes), et créent des expériences candidats inégales. SHRM (Society for Human Resource Management) confirme ce constat : l’inconsistance des évaluations entre managers est l’un des points faibles majeurs dans les dispositifs RH.
Les conséquences sont multiples : décisions biaisées, difficulté à comparer les profils objectivement, confusion entre affinité personnelle et potentiel professionnel. À cela s’ajoutent les risques juridiques liés aux questions non conformes, et l’impact sur la marque employeur lorsque l’expérience candidat est perçue comme approximative ou injuste.
Former les managers à l’entretien de recrutement, ce n’est pas les transformer en spécialistes RH. C’est leur permettre de structurer leurs observations, de mieux comprendre leurs biais, de poser des questions adaptées, et de mieux collaborer avec les équipes RH. Des formats courts, très pratiques, basés sur des mises en situation, des jeux de rôle, ou des grilles d’analyse comportementale partagées, permettent une montée en compétence rapide.
Ce type d’approche, inspiré des meilleures pratiques internationales, professionnalise la posture du manager sans l’alourdir. Elle garantit un processus plus juste, plus aligné avec les besoins réels de l’organisation, et contribue à faire du recrutement un acte stratégique partagé, et non une simple délégation.
Recruter avec justesse : une responsabilité éthique et stratégique
Recruter, c’est aussi projeter une image de l’entreprise. C’est dire à quel point on valorise la diversité des profils, l’évolution des compétences, l’attention au facteur humain. Dans un marché du travail où les candidats peuvent évaluer les recruteurs aussi facilement que l’inverse, chaque entretien devient un moment-clé.
Pour les RH, cela pose une véritable question de posture : voulons-nous être les garants de la conformité administrative, ou les facilitateurs de la rencontre juste ? Cette responsabilité est éthique, car elle touche à l’accès au travail. Mais elle est aussi stratégique : un recrutement réussi, ce n’est pas juste un bon profil, c’est un collaborateur qui s’inscrit durablement et fait évoluer son environnement.
Les compétences invisibles ne sont pas des mystères impalpables. Elles demandent simplement une posture différente, une rigueur d’observation, et parfois un pas de côté. Recruter avec justesse, c’est accepter de ne pas tout contrôler, mais de savoir mieux discerner.
C’est dans cet espace que la fonction RH retrouve toute sa pertinence : entre l’analyse et l’intuition, entre la méthode et l’écoute, entre ce qui se voit et ce qui se révèle.

par Content Manager | 3 Juil 2025 | assessment rh, compétences, Compétences numériques, digitalisation rh, Formation, Formation Entreprise, formation rh, fribourg, generation z, geneve, Neuchâtel, recrutement, Ressources Humaines, soft skills, zurich
Recrutement, formation, évolution des générations, soft skills, digitalisation… Les défis s’accumulent, mais les Ressources Humaines ont aujourd’hui l’opportunité de réinventer leur rôle stratégique. En Suisse, cette transformation est déjà en cours — et elle commence souvent par une remise en question constructive. Une fonction RH plus outillée, plus consciente, peut devenir un levier décisif pour faire grandir l’organisation.
Une fonction RH en pleine redéfinition
Pendant longtemps, la fonction RH a été perçue comme un service support, garant des process administratifs et du respect du droit du travail. Aujourd’hui, ce modèle montre ses limites. Les enjeux actuels dépassent largement la simple conformité : il s’agit de construire une culture, d’accompagner les transformations, de faire vivre une vision à travers les talents.
En Suisse, dans un contexte marqué par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, la transformation digitale et l’évolution des attentes sociétales, les RH doivent devenir des partenaires stratégiques. Cela suppose une nouvelle posture : plus proactive, plus influente, plus connectée aux réalités humaines.
Recruter à l’ère des compétences invisibles
Recruter aujourd’hui, c’est naviguer dans l’incertitude. Les parcours ne sont plus linéaires, les expériences ne se résument pas à un CV, et les compétences comportementales prennent souvent le pas sur les savoir-faire techniques.
Mais comment détecter l’intelligence relationnelle, la capacité d’adaptation ou la résilience à travers un entretien ? Comment éviter les biais de confirmation ? Beaucoup de recruteurs se retrouvent seuls face à ces enjeux.
Une approche structurée — fondée sur l’observation, les mises en situation, les bonnes questions — permet de sécuriser les recrutements tout en respectant la singularité des candidats. Ce savoir-faire ne s’improvise pas : il se développe à travers des formations concrètes, directement applicables.
Transmettre ne s’improvise plus
Le savoir technique ne suffit plus. Dans un monde en constante évolution, transmettre efficacement devient un enjeu stratégique : pour intégrer rapidement de nouveaux collaborateurs, pour maintenir les compétences critiques dans l’entreprise, pour accompagner les changements internes.
Pourtant, nombreux sont les experts métier propulsés formateurs du jour au lendemain, sans outils pédagogiques ni accompagnement. Résultat : des formations peu dynamiques, où l’attention retombe vite, et où l’impact réel est difficile à mesurer.
Se former au rôle de formateur, c’est acquérir des méthodes concrètes pour structurer un module, captiver son public, évaluer les acquis. C’est aussi adopter une posture différente : plus centrée sur l’apprenant, plus orientée vers l’impact. Dans une logique de learning culture, c’est un levier décisif pour les RH suisses.
Générations Y et Z : contrainte ou richesse ?
Dans les entreprises, le dialogue intergénérationnel est parfois complexe. Les plus jeunes attendent flexibilité, feedback, autonomie et sens. Les plus expérimentés valorisent la stabilité, l’expertise, et la loyauté à long terme. Chacun pense parfois que l’autre « ne comprend pas le monde du travail ».
Plutôt que d’opposer ces visions, il est possible de construire une culture inclusive, qui valorise les complémentarités. Mais cela demande une vraie lecture des comportements, des besoins et des ressorts motivationnels propres à chaque génération.
Des formations dédiées permettent de décoder ces différences, d’ajuster les styles managériaux et de créer un climat de confiance. Car au fond, chaque génération aspire à la reconnaissance et à l’utilité — simplement, pas de la même façon.
Et si les outils digitaux servaient l’humain ?
L’automatisation des tâches RH progresse à vive allure : sourcing via IA, onboarding numérique, gestion des performances par plateforme, LMS pour la formation… Ces outils ne sont pas neutres. Mal utilisés, ils déshumanisent ; bien intégrés, ils libèrent du temps pour l’essentiel.
Or, beaucoup de professionnels RH sont encore peu accompagnés dans la prise en main de ces solutions. Ou bien, ils les subissent dans une logique descendante, technocentrée.
Se former à la digitalisation RH, ce n’est pas devenir technicien. C’est comprendre les enjeux derrière les outils, choisir ceux qui ont du sens, et les intégrer à une vision stratégique centrée sur les personnes. En Suisse, où la culture managériale reste attachée à la relation humaine, cette hybridation est cruciale.
Outiller les RH, c’est outiller l’entreprise
Loin d’être une fin en soi, la formation RH est un levier de transformation. Elle donne aux professionnels les clés pour naviguer dans un monde incertain, pour mieux comprendre les humains qu’ils accompagnent, et pour contribuer activement à la stratégie de l’entreprise.
En Suisse, les entreprises qui investissent dans la montée en compétences de leurs RH investissent aussi dans la durabilité de leur culture, la qualité de leur recrutement, et la fluidité de leurs transitions internes.

par Content Manager | 23 Juin 2025 | Formation Entreprise, Ressources Humaines, service client
Pourquoi tant d’entreprises peinent-elles à bâtir une vraie fidélisation client, malgré des produits solides et des commerciaux aguerris ? Parce qu’elles oublient un levier fondamental : la qualité des interactions humaines à tous les niveaux. Et cette relation client ne se joue pas uniquement au téléphone ou en rendez-vous. Elle s’enracine dans la culture interne, la manière de former les équipes, de piloter les compétences, et de faire des RH un moteur stratégique.
Pourquoi les clients partent ?
C’est une question qui revient sans cesse dans les comités de direction. On révise les scripts de vente, on change d’outil CRM, on redessine l’offre. Pourtant, malgré ces efforts, parfois les clients ne restent pas. Dans un monde où l’instantanéité est reine, la fidélité devient un graal – et une source d’angoisse.
Mais cette fidélité, contrairement à une idée reçue, ne dépend pas uniquement du produit ni même du vendeur. Elle se construit à travers des gestes, des attentions, une cohérence d’expérience. Et cela implique bien plus que les commerciaux : cela engage toute l’organisation. La vraie question devient alors : l’entreprise est-elle prête à écouter son client ? Ou attend-elle qu’un service isolé le fasse à sa place ?
La relation client n’est pas qu’une affaire de vendeurs
Dans les entreprises suisses – en particulier les PME et les structures multisites – les fonctions commerciales sont souvent sous pression : conquérir, convaincre, conclure. Mais la vente, aujourd’hui, n’est plus un acte ponctuel. C’est une dynamique continue, où chaque interaction compte.
Un collaborateur technique qui intervient chez le client, un employé administratif qui répond à une demande de facture, un formateur qui accompagne une prestation : tous, à leur manière, influencent la perception de l’entreprise. Et donc la fidélité.
Former à la relation client ne devrait pas être réservé aux commerciaux. C’est un enjeu transversal. Ce que les RH peuvent – et doivent – orchestrer.
Des compétences humaines avant tout
Les compétences commerciales du XXIe siècle ne sont plus seulement des techniques de persuasion. Elles reposent sur des aptitudes humaines : empathie, écoute, assertivité, capacité à créer du lien, à anticiper les besoins.
Ces qualités sont présentes dans bien des profils, souvent insoupçonnés : chefs de projet, responsables qualité, support client, consultants internes… Encore faut-il les identifier, les valoriser, les développer. Cela demande un travail de fond sur la gestion des compétences, les plans de formation et la culture managériale.
Fidélisation externe, engagement interne
On l’oublie souvent, mais la fidélisation client commence… par celle des collaborateurs. Une entreprise incapable de créer de la loyauté en interne aura bien du mal à la générer à l’extérieur. Le turnover, l’usure psychologique, le manque de reconnaissance minent la qualité de la relation client.
À l’inverse, les entreprises qui misent sur l’intelligence collective, la montée en compétence et la responsabilisation de leurs équipes génèrent naturellement une meilleure expérience client. Non pas par injonction, mais par alignement. Par cohérence.
Vers une culture relationnelle
Ce que nous disent les meilleurs programmes de formation en acquisition et fidélisation client, c’est qu’il ne s’agit pas simplement de vendre mieux. Il s’agit d’ancrer une culture de la relation dans l’entreprise. Une culture qui traverse les hiérarchies, qui valorise l’écoute, qui transforme le feedback client en levier d’innovation.
Pour les RH, cela implique de sortir d’une logique de formation « ciblée » pour entrer dans une logique de transformation : cartographier les compétences relationnelles, repenser les parcours, former des profils hybrides, créer des ponts entre les métiers.
La fonction RH à la croisée des chemins
Il ne s’agit plus de se demander si la fonction RH doit soutenir la performance commerciale. La vraie question est : peut-on encore séparer les deux ? Dans une économie de services, dans une société où la confiance devient une denrée rare, l’acquisition et la fidélisation client deviennent des affaires humaines. Et donc, par essence, des affaires RH.
Les entreprises qui réussiront demain ne seront pas celles qui vendent le mieux. Mais celles qui auront su former leurs équipes à incarner leur promesse.

par swissnova | 2 Juin 2025 | Communication professionnelle, Compétences numériques, Développement personne
Nous avons tous des souvenirs d’un chef ou d’une cheffe qui nous a vraiment touchés par sa façon d’être. Nous n’avons pas forcément des souvenirs de ce qu’ils nous ont dit, mais plutôt des émotions qu’ils ont suscitées en nous. Un bon leadership peut être difficile à cerner et à comprendre. Vous connaissez un bon leader quand vous travaillez pour lui. Mais même ces leaders-là peuvent avoir du mal à expliquer les spécificités de ce qu’ils font et qui rend leur leadership si efficace. Un grand leadership est dynamique, il combine une variété de compétences uniques dans un ensemble intégré.
Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle
Selon la définition de Daniel Goleman (1995) qui est la plus répandue dans le monde de l’organisation : « L’intelligence émotionnelle est une métacapacité à dialoguer avec ses émotions et celles des autres pour renforcer la qualité et la puissance de ses relations. » Nous sommes confrontés à l’intelligence émotionnelle quotidiennement, car c’est un ensemble de savoir-faire et de savoir-être comportementaux et cognitifs qui nous permettent d’accroître la gestion de nos propres émotions et celles d’autrui. Elle se mesure par le quotient émotionnel (QE) et elle peut se développer à tout âge. La maîtrise de ses émotions et celles de ses collaborateurs est liée au processus qui conduit à la connaissance de soi et des autres.
Pourquoi mettre l’intelligence émotionnelle (IE) dans son management ?
Souvent, nous jugeons l’intelligence et le leadership en nous basant sur le QI, les compétences techniques et l’expérience, mais en négligeant la composante essentielle de l’intelligence émotionnelle. Les études de Gallup montrent que 70% de la motivation d’un employé est influencée par son manager. Il n’est pas étonnant que les employés ne quittent pas leurs emplois, mais leurs managers. Mettre l’intelligence émotionnelle (IE) dans son management, c’est s’adapter à un environnement professionnel changeant, complexe et plutôt violent. Cette violence n’est pas physique, mais économique, psychologique et sociale. Il est primordial pour les managers d’aujourd’hui de comprendre l’impact de l’IE sur la réussite et la motivation de l’équipe, car elle est la compétence indispensable. Selon Daniel Goleman, qui a auditionné des centaines d’entreprises, étudié des milliers de cas et en a tiré les conclusions suivantes : les personnes qui réussissent, les managers qui sont les plus efficaces, les chefs d’entreprise qui prospèrent ne sont pas ceux qui ont le meilleur QI, mais bien ceux qui disposent d’un bon QE. L’étude du Dr Travis Bradberry sur l’intelligence émotionnelle des personnalités sur le lieu de travail a découvert que l’intelligence émotionnelle était le meilleur indicateur de la haute performance dans tous les types d’emplois. Le QE d’un dirigeant augmente au fur et à mesure qu’il gravit les échelons de la hiérarchie. Il augmente et culmine au niveau du manager et tombe de manière significative au poste de CEO.
Comment utiliser l’intelligence émotionnelle dans son management ?
Tout d’abord, le manager doit prendre conscience de ses propres émotions.
Lorsqu’il comprend le processus déclencheur de ses réactions émotionnelles : ses peurs, ses colères, ses tristesses et ses joies. Il pourra alors apprendre comment les exprimer, les maîtriser et les contrôler. Cette connaissance lui permet de mieux analyser ses comportements face à des situations managériales délicates (conflits, pressions…) afin de mieux réussir à piloter ses émotions, et à prendre de la distance pour mieux assumer ses responsabilités.
Ensuite, il est essentiel de savoir gérer les émotions de ses collaborateurs.
La manager doit apprendre à développer son empathie qui est une qualité nécessaire pour motiver et faire adhérer ses collaborateurs. L’écoute active et la disponibilité permettent de mieux repérer leurs émotions. Le manager doit faciliter l’expression de chaque collaborateur individuellement et en équipe cela l’aide à faire le diagnostic de leurs points forts, leurs axes de progrès, leurs besoins et résistances. Une fois que ce travail est fait, il est beaucoup plus facile de transformer les désaccords en opportunités de coopération et de partenariat et de ramener l’équilibre dans le climat émotionnel de l’entreprise. Les personnes ayant un QE élevé équilibrent les bonnes manières, l’empathie et la gentillesse avec la capacité de s’affirmer et d’établir des limites. Cette combinaison délicate est idéale pour gérer les conflits. Lorsque la plupart des gens se croisent, ils adoptent par défaut un comportement passif ou agressif. Les personnes émotionnellement intelligentes restent équilibrées et autoritaires en s’éloignant des réactions émotionnelles non filtrées. Cela leur permet de neutraliser les personnes difficiles et toxiques sans créer d’ennemis. Le contexte économique moderne nécessite donc une adaptation des méthodes de management. En effet, il s’agit de manager des êtres humains qui sont par définition complexes, car lorsqu’ils sont affectés par des émotions positives ou négatives cela représente respectivement des facteurs bénéfiques ou défavorables en terme : d’engagement, de motivation, de qualité de vie au travail, d’efficacité, d’épanouissement et de risques psychosociaux.
L’intelligence émotionnelle permet un management plus efficace et plus agile dans la motivation des équipes, afin d’aborder les changements avec des collaborateurs acteurs et non spectateurs.
Texte par Nhu Pagliara Sources : Manager avec l’intelligence émotionnelle chez Manager Humain Comment émouvoir le travail avec l’intelligence émotionnelle par le Blog L’entreprise Différents articles de Talent Smart dont « Les 11 signes qui montrent que vous manquez d’intelligence émotionnelle. » Photo credit : John Lester via flickr.com (Creative Commons)

par swissnova | 26 Mai 2025 | Culture d'Entreprise, Formation Entreprise, Management & Leadership, Transformation Digitale
L’intelligence artificielle bouleverse l’entreprise : pourquoi former n’est plus une option
L’intelligence artificielle n’est pas une révolution technologique à venir. Elle est déjà là, et elle transforme silencieusement les pratiques, les outils, les métiers — parfois sans que les décideurs aient eu le temps de prendre du recul. Elle bouleverse les hiérarchies de compétences, réinterroge la notion de valeur ajoutée humaine, et rebat les cartes du leadership.
Or dans la majorité des organisations, la réponse à cette transformation reste essentiellement technique. On implémente des solutions. On teste des outils. Mais on oublie souvent l’essentiel : former, acculturer, accompagner.
Et ce n’est pas un enjeu réservé aux développeurs. L’IA touche le marketing, les RH, la finance, la stratégie, le middle management… . Former devient une condition de lucidité opérationnelle, d’agilité organisationnelle et de souveraineté intellectuelle.
Les entreprises qui survivront ne sont pas celles qui intègrent le plus vite l’IA, mais celles qui comprennent ce qu’elle change vraiment, et adaptent leurs compétences en conséquence.
Les angles morts de l’inaction : que risque une entreprise qui n’accompagne pas ses équipes ?
Adopter l’intelligence artificielle sans former, c’est comme confier une Formule 1 à un conducteur non inité : on peut aller vite, mais on ne sait ni où ni comment on s’arrête.
Voici ce que nous constatons sur le terrain, dans les entreprises qui avancent à l’aveugle :
1. Mauvaise utilisation des outils : gain de temps fictif, perte de contrôle, absence de sens critique. L’outil fait, mais l’humain désengagé délègue sans comprendre.
2. Jugements managériaux erronés : stratégies orientées par effet de mode, décisions sur-équipées mais sous-analysées. Sans grille de lecture solide, même le top management perd ses repères.
3. Déficit éthique : l’IA reproduit les biais des données. Si personne ne les reconnaît, on valide des pratiques discriminantes.
4. Risques légaux et de conformité : RGPD, confidentialité, responsabilité algorithmique… Former, c’est aussi protéger.
5. Démotivation et résistance au changement : la peur remplace la compréhension. L’IA devient un facteur de tension au lieu d’être un levier de transformation.
Former n’est pas un « bonus ». C’est une assurance organisationnelle face à un choc systémique.
Quelle formation IA pour quels profils ? Construire une culture d’entreprise adaptée au XXIe siècle
Si l’on reconnaît que former est essentiel, encore faut-il savoir quoi former, qui, et comment.
L’IA impacte désormais tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique ou leur fonction. Car au-delà des usages professionnels, elle influence aussi notre quotidien : gestion de l’information, rapport au travail, relation à la vérité, autonomie numérique. Former à l’IA, c’est donc aussi renforcer l’employabilité et l’autonomie de chacun dans un monde en mutation.
1. Dirigeants : stratégie et gouvernance Ils doivent comprendre l’impact de l’IA sur les modèles d’affaires, les chaînes de valeur, la place de l’humain. Il ne s’agit pas de coder, mais de piloter avec lucidité.
2. Managers : cas d’usage et accompagnement des équipes Le middle management est clé dans la transformation. On forme ici à identifier les bons outils, à créer du dialogue, à rassurer sans freiner.
3. Fonctions opérationnelles : autonomie et cadre Des outils existent, mais sans formation, leur usage est souvent erratique. Il faut transmettre des compétences critiques, des réflexes éthiques, des bonnes pratiques concrètes.
4. Collaborateurs de tous horizons : culture numérique et maîtrise citoyenne Comprendre l’IA, ce n’est pas seulement optimiser son travail. C’est aussi savoir en parler, en faire un usage raisonné, et l’intégrer dans sa vie quotidienne. L’inclusion numérique est un enjeu social autant qu’un levier RH.
Une entreprise prête pour l’IA, ce n’est pas une entreprise qui a acheté des logiciels. C’est une organisation où chaque niveau comprend son rôle face à la machine.
Plutôt que de répondre à l’enthousiasme technologique ambiant, il devient essentiel de décaler le regard. L’enjeu de l’IA n’est pas uniquement celui des outils, mais celui de la compréhension partagée, de la capacité à faire sens collectivement face à des systèmes complexes et ambigus.
Il ne s’agit plus simplement de suivre le mouvement, mais d’y apporter de la maîtrise, de la distance critique, et une responsabilité humaine. L’intelligence artificielle pose une question de culture organisationnelle avant même d’être un choix technique. Ce n’est pas un sujet pour les seuls experts, mais un défi transversal, sociétal et durable.
Former aujourd’hui, c’est construire une entreprise capable de dialoguer avec son temps. De rester actrice, et non spectatrice, de la transformation.
Formations, ateliers, coachings, simulations : chaque entreprise a son propre chemin, mais toutes ont besoin de le tracer. pour que la technologie serve la culture, et non l’inverse.
Besoin d’ouvrir la discussion dans votre organisation ? Parlons-en

par swissnova | 19 Mai 2025 | Innovation managériale, Leadership & Gouvernance, Management & Organisation, Transformation d'entreprise
Pourquoi les modèles actuels montrent leurs limites
Alors que les entreprises sortent tant bien que mal de plusieurs années de turbulence – pandémie, inflation, ruptures de chaînes logistiques, transitions numériques – un autre chantier se dessine plus en profondeur : celui du management.
Les catégories traditionnelles – leader, manager, cadre – semblent de moins en moins adaptées aux enjeux contemporains. Derrière la prolifération des discours sur l’“agilité”, le “bien-être au travail” ou le “leadership inspirant”, une interrogation fondamentale émerge : et si les structures de pouvoir, plus que les personnes, étaient à repenser ?
Leadership ou coordination collective ?
Le XXe siècle a produit un imaginaire managérial centré sur la figure du leader : charismatique, visionnaire, moteur de transformation. Ce modèle reste vivace dans la littérature professionnelle, les séminaires RH ou les cursus MBA.
Mais dans un monde désormais marqué par l’incertitude permanente et la complexité systémique, ce paradigme montre ses limites.
Des chercheurs comme Henry Mintzberg ou Frédéric Laloux soutiennent une autre approche : le leadership distribué, où la performance organisationnelle repose moins sur un individu que sur la capacité d’un collectif à s’auto-organiser, décider, apprendre.
Cela suppose une rupture culturelle : passer d’un management fondé sur le contrôle à une logique de confiance et de subsidiarité.
Le malaise managérial, un symptôme systémique
Les enquêtes se suivent et se ressemblent : hausse des burn-out chez les cadres, démissions silencieuses, crise de sens chez les managers intermédiaires.
On leur demande tout à la fois d’être stratèges, coachs, garants de la cohésion d’équipe et vecteurs de performance. Cette surcharge de rôles traduit moins une incompétence qu’un déséquilibre structurel.
Le management devient alors un espace de tension, où les objectifs économiques à court terme entrent en conflit avec les attentes humaines, éthiques, environnementales.
Repenser les fonctions managériales : une urgence organisationnelle
Nombre d’organisations tentent d’adapter leurs pratiques : holacratie, modèles « opales », co-développement, coaching d’équipe, intelligence collective… Ces tentatives révèlent une chose : le besoin d’explorer d’autres configurations de pouvoir, d’autorité et de prise de décision.
Mais il ne s’agit pas d’un simple ajustement technique. C’est un travail de fond, qui engage des choix culturels, des arbitrages politiques, et souvent un changement de posture de la part des dirigeants eux-mêmes.
Et maintenant ?
La transformation du management ne passera ni par une nouvelle méthode miracle, ni par une multiplication de formations sur le “savoir-être”. Elle exige un travail réflexif, collectif et itératif sur ce que signifie aujourd’hui “diriger”, “coordonner”, “mobiliser”.
Il est temps de poser les vraies questions :
Qu’est-ce qu’un pouvoir légitime dans une organisation ?
Quelle place pour la parole, le désaccord, l’initiative ?
Comment redéfinir la responsabilité sans la diluer ?
Envie d’approfondir ?
Certaines structures – instituts de recherche, collectifs de praticiens, centres de formation – accompagnent ce travail de réflexion sans imposer de modèle. À titre d’exemple, Swissnova propose des espaces de discussion et d’expérimentation autour des nouvelles formes de management. Une approche moins prescriptive que participative, qui privilégie les questions aux réponses toutes faites.
Cet article s’inscrit dans une série de réflexions sur l’évolution du management contemporain. Il ne vise pas à promouvoir un modèle unique, mais à ouvrir des pistes de réflexion, à partir des tensions observées dans les pratiques actuelles.

par swissnova | 13 Mai 2025 | Ergonomie, management, Ressources Humaines, santé
En Suisse comme dans l’ensemble des pays européens, les TMS (troubles musculo-squelettiques) représentent la première cause de maladie professionnelle.
Dos, épaules, poignets, cervicales : certaines douleurs peuvent s’installer durablement dans le quotidien de travail, affecter la performance, et générer fatigue, absentéisme, voire incapacité prolongée.
Les causes ? Des gestes répétitifs, des postures inadéquates, une pression constante, un aménagement de poste non pensé pour préserver l’équilibre global du corps.
Pourquoi cette problématique est critique pour les RH ?
Parce qu’un TMS mal pris en compte coûte cher en:
- absentéisme à répétition,
- temps de remplacement,
- usure morale et sentiment d’injustice.
Mais aussi parce qu’il porte souvent une charge invisible : le stress organisationnel, la surcharge cognitive, un management peu attentif aux signaux faibles. Or, quelques ajustements bien ciblés permettent souvent de prévenir durablement ces risques.
Des leviers concrets à mobiliser dans l’organisation
Il est possible (et nécessaire) de co-construire une démarche de prévention intégrée grâce à :
- Une analyse ergonomique des postes de travail.
- La formation aux gestes et postures adaptés.
- Des bilans réguliers sur les attitudes à risque.
- Une culture de la vigilance partagée entre RH, encadrants et collaborateurs.
Chez les employeurs pionniers, la prévention des TMS s’inscrit dans une logique QVT (qualité de vie au travail) et QVCT (qualité de vie et des conditions de travail).
La formation : un socle pour faire évoluer les comportements
Former à la prévention des TMS permet de :
- Sensibiliser aux facteurs de risques,
- Modifier les comportements ancrés mais non efficaces,
- Maintenir les performances dans la durée tout en protégeant la santé.
Ces formations alternent théorie, situations concrètes terrain, exercices corporels ou modules de microlearning ciblé. Elles s’adressent à tous : métiers physiques, écran, logistique, bureau, encadrement, etc., .
Et maintenant… qui prend soin du corps au travail ?
À l’heure où l’on parle de transition écologique, de RSE et de performance responsable, pourquoi la question du corps au travail reste-t-elle aussi peu visible ?
Comment associer prévention physique et prévention mentale ?
Et surtout : qui pilote en interne ces transitions santé dans les organisations ? Le RH, le QHSE, la direction, tous ensemble ?
Des questions fondamentales pour enclencher une approche pérenne du bien-être et de la performance.